




L'humain est un animal social. Il peine à travailler seul, et quand ça lui arrive, il peine à être à son meilleur. Pour le prouver, des chercheurs du MIT ont fait quelque chose d'improbable : ils ont accroché des capteurs au cou d'employés d'un centre d'appels. Ce qu'ils ont découvert a changé notre compréhension du travail en équipe — et accessoirement, sauvé 15 millions de dollars.
Nous sommes au milieu des années 2000. Alex «Sandy» Pentland dirige le Human Dynamics Lab au MIT Media Lab. Le chercheur a une obsession : mesurer ce qui n'a jamais été mesuré : les conversations de corridor. Échanges informels, bavardage, potins... tout ce que les anglophones appellent le small talk, ou encore les water cooler talks, ces discussions entre collègues autour de la machine à café ou de la fontaine d'eau.
Pour ce faire, Pentland et son équipe — Benjamin Waber, Daniel Olguin et Taemie Kim — ont mis au point un outil étonnant : le badge sociométrique. Un petit boîtier en plastique, accroché au cou, de la taille d'un paquet de cartes. À l'intérieur : un émetteur Bluetooth, un microphone, un accéléromètre et un ensemble de capteurs de mouvement. Le badge ne capte pas ce que vous dites. Il capte comment vous le dites, en combien de temps, à quelle fréquence, et à qui. Il mesure aussi votre posture, votre niveau d'énergie, votre ton de voix. Bref, il mesure tout ce que vous ne dites pas pendant que vous parlez.
Pentland va déployer ses badges dans un lieu parfait pour son étude : le centre d'appels d'une grande banque américaine. C'est un environnement ultramesuré. Chaque seconde de chaque appel est comptée. La productivité se calcule en average handle time — le temps moyen de traitement d'un appel : plus il est court, meilleure est la performance.
Et justement, dans cette logique d'optimisation, la direction avait pris une décision qui semblait parfaitement rationnelle : les pauses café étaient décalées. Chaque employé prenait sa pause seul, à un moment différent de ses collègues, pour qu'il y ait toujours quelqu'un au téléphone. Zéro temps mort. Une efficacité maximale. Du moins, c'est ce qu'on croyait.
Pendant six semaines, les équipes ont porté les badges du professeur. Les capteurs enregistraient tout. Les badges captaient la durée des conversations face à face, la fréquence des interactions entre collègues, le ton de la voix et son volume, les mouvements et la posture du corps, et surtout avec qui chaque employé parlait. Ils détectaient si deux personnes se faisaient face pendant un échange ou si elles se parlaient de dos en marchant dans un corridor. Bref, les badges mesuraient tout ce qu'un gestionnaire ne voit jamais sur un tableau de bord.
L'équipe du MIT a accumulé plus de 2 000 heures de données comportementales — des dizaines de gigaoctets d'interactions humaines réduites en chiffres. En parallèle, les employés remplissaient chaque jour un court questionnaire : Quel était votre niveau de productivité aujourd'hui ? Votre satisfaction ? La qualité de vos interactions de groupe ? Les chercheurs pouvaient ainsi croiser ce que les capteurs observaient avec ce que les employés ressentaient.
Et ce qu'ils ont découvert va à l'encontre de toute logique...
Premier constat : les meilleurs prédicteurs de productivité n'étaient ni l'ancienneté, ni la formation, ni même l'intelligence individuelle des employés. C'était l'énergie et l'engagement... en dehors des réunions formelles. Ces deux facteurs à eux seuls expliquaient un tiers des variations de productivité entre les équipes.
Deuxième constat : la cohésion de groupe — définie comme le degré de connexion entre les membres d'une même équipe, la fréquence à laquelle ils se parlent, et à quel point leur réseau est interconnecté — était un prédicteur central de la performance. Les employés dont la cohésion de groupe se situait dans le tiers supérieur affichaient une productivité supérieure de plus de 10 %.
Troisième constat (fascinant) : les employés qui, malgré les pauses décalées, avaient quand même trouvé le moyen de bavarder avec leurs collègues étaient systématiquement plus performants que les autres.
La conclusion était limpide. Pentland a recommandé au gestionnaire du centre d'appels de faire exactement le contraire de ce que dictait la logique d'efficacité : synchroniser les pauses. Que tout le monde prenne son café en même temps.
Mettez-vous à la place du gestionnaire. Vous optimisez chaque seconde de chaque appel depuis des années. Et un professeur du MIT débarque dans votre bureau pour vous dire que la solution, c'est que tout le monde arrête de travailler en même temps. Pentland raconte que le gestionnaire était « perplexe et désespéré ». Et on le comprend.
De bonne guerre, ce dernier décide de « poursuivre l'aventure » et d'effectuer les changements « illogiques » proposés par le MIT.
Résultat? Le centre d'appels avait plusieurs équipes, et elles ne performaient pas toutes au même niveau. Quand ils ont synchronisé les pauses, toutes les équipes se sont améliorées, mais pas de la même façon. Les équipes qui étaient à la traîne — celles qui avaient les temps d'appel les plus longs — ont vu leur average handle time (le temps moyen pour traiter un appel, du début à la fin) chuter de 20 %. Les équipes qui performaient déjà bien se sont aussi améliorées, mais moins drastiquement. Si on fait la moyenne de toutes les équipes confondues, la baisse était de 8 %.
Dans le même temps, la satisfaction des clients est restée stable. Le stress des employés a diminué. Le roulement de personnel aussi. Quand la banque a projeté ces résultats à l'échelle nationale, le gain estimé était de 15 millions de dollars par année.
Quinze millions. Avec des pauses café.
Alors que se passe-t-il, exactement, autour de cette machine à café ?
Les gens jasent. Ils potinent. Mais au-delà des ragots et des anecdotes, c'est un véritable théâtre de formation directe qui se forme. « J'ai eu un client vraiment fâché au téléphone, et j'ai fait telle chose. » « Le système a planté, mais j'ai trouvé un raccourci. » « Quand quelqu'un te demande de parler à un superviseur, dis ceci plutôt que cela. » Les gens se racontent des histoires, et ils se forment les uns les autres.
Voilà le mécanisme. Les trucs pour désamorcer un appel difficile, les raccourcis que personne n'a documentés, la bonne phrase pour calmer un client qui menace d'annuler son compte — ce savoir-là ne se trouve dans aucun manuel, dans aucun mémo, dans aucune formation. Il circule de bouche à oreille, entre deux gorgées de café. Et quand on empêche les gens de se parler — en décalant leurs pauses, en les isolant dans des quarts solitaires — on se prive de ce flot de savoirs précieux.
L'histoire de Pentland rejoint une intuition que nous avons souvent chez Perrier Jablonski : on ne comprend pas les organisations en regardant leurs organigrammes. On les comprend en observant les gens interagir. Les vraies dynamiques d'une équipe ne se trouvent pas dans les processus formels, mais dans les interstices — les corridors, les cafétérias, les minutes perdues entre les réunions.
Pentland en tire une formule qui devrait trôner dans le bureau de chaque gestionnaire : pour être plus productif, écrivez moins de mémos et prenez plus de pauses café.
C'est contre-intuitif. C'est dérangeant pour quiconque gère un budget serré et des équipes sous pression. Mais les données sont là : la cohésion sociale n'est pas un luxe ni une distraction. C'est un levier de performance aussi mesurable qu'un indicateur financier. Et dans un monde où le télétravail, les horaires atypiques et les équipes distribuées fragmentent les interactions informelles, cette découverte du MIT n'a jamais été aussi pertinente.
Alors la prochaine fois qu'un collègue vous invite à prendre un café, dites oui. Ce n'est pas une perte de temps... C'est peut-être un investissement de 15 millions de dollars.
Des chercheurs du MIT ont équipé des employés d'un centre d'appels de badges mesurant leurs interactions sociales. Résultat : la productivité n'était pas liée à la compétence individuelle, mais à la cohésion du groupe — autrement dit, à la fréquence des échanges informels entre collègues. En synchronisant les pauses café (au lieu de les décaler), la banque a réduit le temps moyen des appels de 8 %, générant des économies estimées à 15 millions de dollars par année. Le savoir le plus utile dans une organisation ne circule pas dans les mémos. Il circule autour de la machine à café.

Nous sommes au début des années 50, l’armée de l’air américaine veut améliorer les performances en vol de ses escadrons. Les mensurations des pilotes ayant changé au fil des années, le temps de repenser le cockpit des appareils est venu. La mission est confiée à la Base de Wright Air Force. 4000 pilotes sont mesurés dans tous les sens, avec un objectif simple : créer le cockpit parfait, le cockpit de tous les cockpits, le cockpit qui conviendrait à tous les pilotes... autrement dit, le cockpit moyen.
Après donc un demi-million de mesures, le cockpit idéal est testé sur les 4000 pilotes. Savez-vous combien de pilotes sont rentrés parfaitement dans ce cockpit? 50, 20, 10, 5? La réponse est devenue une révélation pour tous les innovateurs du monde : zéro. zéro virgule zéro. Aucun pilote! Zéro!!!
Cette incroyable étude menée par les militaires et les scientifiques ne souffrait d'aucune contestation possible, et la morale de l’histoire est simple : la moyenne n'existe pas. C'est à Todd Rose que nous devons cette démonstration étonnante dans une conférence TED, The Myth of Average.
L'usager normal est peu enclin à nommer certains problèmes ou dysfonctionnements. La raison? On s'arrange avec! Regardez le nombre d'objets, de produits ou de services imparfaits autour de nous! On s'adapte, on s'organise, on vit avec. Alors si vous interrogez la moyenne, la probabilité qu'elle ait de grandes révélations à vous faire est faible. Si on me demande s'il est difficile de me servir d'une balayeuse, il se pourrait bien que je le prenne mal... Quand même! Une balayeuse! Mais si on m'observe pendant le ménage, qu'on voit que je galère avec le fil, que je fais la grimace quand le tuyau est coincé dans le coin d'un meuble, qu'on note que je dois la monter du garage, puis la redescendre, en la faisant frotter contre les murs... Tous ces "besoins" sont dits "latents" : ils sont invisibles, et même pas dignes de mention. Alors que les besoins manifestes sont beaucoup plus faciles à obtenir : je veux une balayeuse légère, avec un bon prix et un bon look. Je peux nommer des besoins manifestes universels... mais totalement inintéressants. Ils n'ont pas — ou peu — de valeur. Au final, je me suis offert un robot aspirateur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à le déplacer, parce qu'il n'y a ni fil ni tuyau. J'ai rempli mes besoins latents avec un produit qui n'a pas tenté de simplement remplir des besoins évidents, manifestes.
Imaginer un produit pour la moyenne des consommateurs, c'est imaginer un produit pour... personne. Alors à qui faut-il penser? Aux usagers extrêmes. Ces utilisateurs extrêmes sont étudiés à la loupe par celles et ceux qui veulent surprendre le marché, car ils sont plus bavards que les utilisateurs moyens. Ils ont des choses à vous dire et voici qui ils sont.
Ils ne sont pas encore vos clients. Ils ne le seront jamais si vous n’inventez rien pour eux. Les non-utilisateurs peuvent fournir des informations sur les raisons pour lesquelles ils ne sont pas des utilisateurs actuels d'un produit ou d'un service. Cela peut inclure des obstacles tels que le coût, la complexité ou le manque de conscience de l'existence du produit ou du service. Ils peuvent également fournir des informations sur les besoins non satisfaits, des préférences qui ne sont pas prises en compte par les produits ou services existants. Ces informations sont précieuses pour diversifier un marché, explorer un segment de marché sous-estimé ou "mal traité".
Voici un exemple connu, celui de McDonald’s qui a tenté de mieux comprendre les végétariens qui fuyaient la marque. Résultat : aujourd'hui, McDonald’s a ajouté des formules végétariennes à son menu avec un grand succès.

Ce sont des utilisateurs un peu incompétents avec votre produit. Malhabiles. Débutants. Ils sont moins forts que la moyenne, mais beaaaaaucoup plus bavards. Ils n'ont pas de honte à nommer ceci ou identifier cela. Parfois un handicap peut les empêcher d'utiliser un produit ou un service, ils vont être alors plus enclins à faire des demandes précises. Il peut d'agir aussi d'incompétence pure : "je ne connais rien à la course à pied, mais j'aimerais m'y mettre". On peut aussi penser aux débutants "je viens d'arriver dans l'entreprise et je ne connais pas les outils à utiliser", etc. Dans tous les cas, leur ego n'est pas mis en jeu lors d'une entrevue. Ils n'ont pas à savoir d'emblée. Alors ils sont libres de nommer les choses telles quelles sont. Cette candeur est très très précieuse.
Un exemple connu : c’est grâce à des personnes âgées atteintes d’arthrite que les designers industriels de Smart Design ont conçu une gamme d’ustensiles de cuisine... utilisés par tout le monde — pour leur client OXO Good Grip. Le cas est d'ailleurs bien documenté ici.

Ils sont plus forts que la moyenne. Ce sont des utilisateurs experts, fidèles. Ils ont des choses à vous dire pour améliorer votre produit. Il peut s'agir d'un chauffeur qui fait plus de 50 000 km par année, et qui peut vous parler de fatigue au volant. Une employée fidèle depuis 15 ans a certainement des choses intéressantes à vous dire sur la culture de l'entreprise. On parle ici des pros, des athlètes de votre produit ou de votre service.
Exemple connu : le détaillant de sport Décathlon effectue de nombreuses recherches avec utilisateurs expérimentés dans tous les sports pour améliorer ses produits. Leur page "innovation" est d'ailleurs très explicite à ce sujet!

Ce sont ces usagers qui se sont débrouillés sans vous, avant vous. Ils sont bricoleurs, curieux, avant-gardistes, savants, et surtout... Ils ont DÉJÀ trouvé la solution... Je me souviens de l'exemple partagé par Louis Garneau. Lors d'une compétition, il s'aperçoit qu'un cycliste avait lacéré ses souliers de vélo pour les aérer et les rendre plus souples. C’est ainsi qu'il a amélioré son modèle en créant une mise à jour... plus aérée et plus souple.

Voilà celles et ceux qu’il faut observer, questionner, comprendre. Ils vous mettront sur la piste de solutions nouvelles et vous permettront d'inventer de nouveaux produits ou services. L'intérêt pour les usagers extrêmes réside dans leur capacité à révéler des problèmes et des opportunités qui pourraient passer inaperçus lorsqu'on se concentre uniquement sur les utilisateurs moyens. Les solutions développées pour répondre aux besoins de ces usagers extrêmes ont souvent le potentiel d'améliorer l'expérience de l'ensemble des utilisateurs. Et c'est ça la beauté de l'exercice! Les usagers extrêmes nomment des besoins latents au nom de la masse. Ils deviennent des porte-parole de l'insight qu'un usage moyen n'aurait jamais osé, jamais pensé, jamais pris la peine de partager avec vous. Chez Perrier Jablonski, c'est un point de départ obligatoire avant tout travail stratégique. Nous cherchons les usagers extrêmes qui pourraient nous mettre sur les bonnes pistes.
Attention : cela n’est pas une garantie de succès commercial... C'est une piste à explorer! Mais si la solution est unique, elle vous donnera un avantage certain face au marché. Dernier exemple pour la route, Yoplait, et ses contenants de 1 litre. Typiquement, la forme de peanut est beaucoup plus facile à agripper... et c'est vrai pour tout le monde. Mais c'est en parlant à des personnes âgées atteintes d'arthrite qu'ils l'ont appris...

La quête de la productivité ne date pas d’hier. Au tournant du 20e siècle, des monuments de la recherche en management tels que Fred Taylor et Henri Fayol se penchaient déjà sur la question. Henri Ford a lui-même inventé la recette de la productivité manufacturière, qui a profondément marqué le monde industriel du 20e siècle. Mais une série d’études en particulier, menées par l’équipe d’Elton Mayo, révèle que l’écoute est l’élément clé de la productivité.
Bâtie en 1905, Hawthorne Works, une immense usine située en Illinois, a souvent servi de laboratoire aux scientifiques voulant étudier les comportements des travailleurs. Et avec raison : à son apogée, près de 45 000 employés y travaillaient, ce qui représentait un échantillon très intéressant pour les chercheurs.
Au cours de trois études conduites entre 1924 et 1927, l’équipe de Mayo a tenté d’observer les facteurs qui influençaient la productivité, de la disposition des espaces de travail aux incitatifs monétaires. Mais l’exemple qui a marqué l’imaginaire est celui de l’éclairage. Les chercheurs ont voulu évaluer l’impact de l’augmentation de l’éclairage sur la productivité, et ont constaté que plus ils augmentaient l’éclairage, plus la productivité augmentait! La satisfaction d’avoir découvert un filon intéressant fut cependant de courte durée : lorsqu’ils ont réduit l’éclairage à un niveau normal, ils ont observé la même augmentation de productivité.
Plusieurs études ont depuis révélé que l’effet du changement des conditions de travail, et plus spécifiquement de l’éclairage, ne peut être démontré scientifiquement en raison du trop grand nombre de variables à contrôler. Toutefois, un facteur précis semble avoir eu un effet réel sur la productivité des employés.
Plusieurs chercheurs ayant revisité les études de l’équipe de Mayo ont noté un fait intéressant. Alors que les équipes étudiées travaillaient auparavant sous le contrôle serré de leurs gestionnaires, les chercheurs ont pris le relais pour la durée du projet de recherche. Ces derniers avaient donc comme mandat de dialoguer et d’écouter les besoins des employés. Selon Mayo, « le plus grand changement s’est produit lorsque les responsables de l’étude ont cherché à obtenir la coopération des travailleurs en comprenant leurs besoins humains ».
L’un des plus grands défis que traversent les entreprises est de parvenir à maintenir un haut niveau de productivité avec une demande plus qu’incertaine, des effectifs réduits et les difficultés liées au télétravail. Il n’existe pas de solution miracle, et nous devrons tous développer la capacité de s’adapter à cette nouvelle réalité.
Cependant, une chose est certaine. Les entreprises ne doivent pas tomber dans la « trappe de la disponibilité infinie » : puisque les employés sont théoriquement toujours disponibles, leur agenda se remplit à une vitesse vertigineuse. Impossible de dire que l’on doit être ailleurs, ou que l’on a un autre rendez-vous, simplement parce que nous sommes tous confinés. Il n’y a pas d’échappatoires. Si on laisse cette pression s’accumuler, nous fonçons tous vers le surmenage.
Un employé productif n’est pas un employé qui a un agenda rempli. Un employé productif est un employé qui produit. Point. Et comme le démontrent les expériences réalisées à Hawthorne il y a près de 100 ans, la productivité survient généralement lorsqu’on écoute plus et que l’on demande moins.
En 2003, LEGO perdait un million de dollars (USD) par jour. Fondé en 1932 dans l’atelier d’un menuisier à Billund, le fabricant danois était en chute libre : 30 % de chiffre d’affaires évaporé en un an, puis encore 10 % l’année suivante. La dette atteignait 800 millions de dollars. À 35 ans, tout juste nommé PDG, Jørgen Vig Knudstorp a résumé la situation avec une franchise brutale : « Nous sommes sur une plateforme en feu. Nous perdons de l'argent, notre flux de trésorerie est négatif, et nous risquons un défaut de paiement qui pourrait entraîner le démantèlement de l'entreprise. »
Comment le roi de la brique en était-il arrivé là? En écoutant les chiffres... plutôt que les enfants.
Depuis le milieu des années 1990, LEGO avait multiplié les diversifications hasardeuses. Parcs à thème, lignes de vêtements, jeux vidéo, émissions télé, magazines, robotique — l'entreprise voulait devenir le Disney du jouet. Le nombre de composants avait explosé, passant de quelques centaines à près de 7 000 pièces différentes, chacune nécessitant un moule coûtant entre 50 000 et 300 000 euros. Les brevets sur la brique d'origine ayant expiré en 1988, la concurrence s'engouffrait dans la brèche pendant que LEGO regardait ailleurs.
Pire encore : toutes les études de marché commandées par l'entreprise convergeaient vers le même diagnostic accablant. Les enfants de la génération numérique n'avaient plus la patience de construire quoi que ce soit. Leur capacité d'attention rétrécissait. Ils voulaient de la gratification instantanée, des écrans, du mouvement. La brique, concluaient les analystes, appartenait au passé.
LEGO a donc fait ce que les données lui dictaient : fabriquer des briques plus grosses, simplifier les modèles, réduire les défis de construction. Rendre le tout plus facile, plus rapide, plus « adapté » aux enfants d'aujourd'hui.
Sauf que... les ventes continuait de plonger.
C'est dans ce contexte de panique que Vig Knudstorp prend une décision contre-intuitive. Plutôt que de commander une énième étude quantitative, il fait appel à ReD Associates, un cabinet de conseil danois fondé par Christian Madsbjerg et Mikkel Rasmussen, qui pratique quelque chose de radicalement différent : l'ethnographie appliquée aux affaires — avouons le sans détour, une firme qui a beaucoup inspiré Perrier Jablonski...
Là où les firmes de recherche traditionnelles distribuent des questionnaires et organisent des groupes de discussion, ReD envoie des anthropologues observer les gens dans leur habitat naturel. Comme le formulait Vig Knudstorp lui-même : « si vous voulez comprendre comment vivent les animaux, vous n'allez pas au zoo — vous allez dans la jungle. »
ReD Associates a donc déployé ses chercheurs dans les chambres d'enfants, les sous-sols et les cours d'école de plusieurs pays. Pas pour poser des questions sur les préférences de teil ou tel produit, mais pour observer, comprendre. Ils étudiaient tout : le contexte, les rituels, les dynamiques sociales, les aspirations non formulées — tout ce que les sondages ne capturent jamais.
Le moment de bascule — ce que Madsbjerg et Rasmussen appellent le moment of clarity — s'est produit au début de 2004, dans la chambre d'un garçon de 11 ans, dans une ville allemande de taille moyenne.
Le garçon était un passionné de LEGO, mais aussi un skateur acharné. Quand l'équipe de recherche lui a demandé quel objet le rendait le plus fier, il n'a pas montré une console de jeu, un téléphone ou même une construction LEGO. Il a pointé du doigt une vieille paire d'Adidas, usée, abîmée, méconnaissable.
Il l'a soulevée comme un trophée. Un côté de la semelle était usé selon un angle très précis. Les talons étaient éraflés d'une manière bien particulière. Chaque marque d'usure racontait une histoire — celle des heures et des heures passées à perfectionner un trick de planche à roulettes. L'état de ces chaussures prouvait, à ses yeux comme à ceux de ses amis, qu'il était l'un des meilleurs skateurs de sa ville. C'était sa preuve tangible de maîtrise.
À cet instant, tout s'est éclairé pour l'équipe LEGO. Comme l'écrit le consultant Martin Lindstrom, qui participait au virage stratégique de l'entreprise : « Ce que des montagnes de recherche consommateur n'avaient pas révélé, un enfant et ses espadrilles venaient de le démontrer. Ère numérique ou pas, les enfants se souciaient profondément de maîtriser une compétence et de pouvoir exhiber la preuve de leur travail. »
La découverte ethnographique renversait totalement le paradigme du big data. Les enfants ne voulaient pas de la gratification instantanée — ils voulaient le défi, l'effort, la fierté de l'accomplissement. Jouer avec des LEGO, ce n'était pas « s'amuser » au sens superficiel du terme. C'était un acte de création, une quête de maîtrise. Ou comme LEGO allait le distiller dans sa nouvelle devise : the joy of building, and the pride of creation.
Les conséquences stratégiques ont été immédiates et radicales. LEGO a ramené ses briques à leur taille normale, puis les a rendues encore plus petites et plus détaillées. Les manuels d'instructions sont devenus plus exigeants. Les défis de construction, plus complexes. Le kit du Death Star, avec ses 3 800 pièces, incarnait parfaitement cette philosophie : un défi ardu qui procurait, une fois terminé, un sentiment d'accomplissement comparable à celui d'un trick de skateboard enfin maîtrisé.
En 2014, portée par le succès planétaire de The Lego Movie et par une décennie de décisions éclairées par la compréhension profonde de ses utilisateurs, LEGO a dépassé Mattel pour devenir le plus grand fabricant de jouets au monde. Son chiffre d'affaires dépassait les 2 milliards de dollars pour le premier semestre seulement.
L'histoire de LEGO n'est pas simplement un cas d'école en redressement d'entreprise. C'est la démonstration éclatante que les données quantitatives, aussi massives soient-elles, ne peuvent pas remplacer la compréhension humaine. Que les algorithmes mesurent les comportements, mais que seule l'ethnographie saisit les motivations. Que la réponse à une question stratégique existentielle se trouvait, ce jour-là, non pas dans un tableau croisé dynamique, mais dans une paire d'espadrilles usées, tenues à bout de bras par un gamin allemand de 11 ans, fier comme un roi.
Sans le savoir, c'est donc une vieille paire d'Adidas qui a sauvé LEGO, ou comme j'aime à le résumer : LEGO a été sauvée par UN ethnographe, qui a observé UN ado.
On est très très loin du big data.
Depuis plusieurs décennies, les départements de marketing et de design se sont emparés d'un vieux terme pour décrire leurs types de clients : le fameux persona. Le persona est un personnage fictif représentant un groupe spécifique de personnes, que l'on va "incarner" par un individu créé de toutes pièces. Il sert de modèle pour comprendre les caractéristiques, les besoins, les préférences et les comportements de ce groupe. Les personas sont souvent créés à partir de recherches et de données sur les utilisateurs réels. Typiquement, on y retrouve les éléments tels que :
De planification stratégique en plan marketing, on voit les départements s'accrocher à leurs personas et en faire de véritables cibles marketing. La raison est facile à comprendre : d'abord, la simplicité. Il est plus facile de nommer Julien ou Marie que "les hommes 25-40 ans en couple, en banlieue" ou "les femmes professionnelles urbaines". Ensuite, une sorte de sentiment d'attachement se crée dans l'organisation. On va plus facilement prendre soin de Claude ou de Carole que d'un "public cible". Quel est le problème alors?
Il en existe plusieurs. D'abord, on voit souvent des contradictions ou des aberrations qui créent des personnages fictionnels, voire des superhéros du quotidien qui finissent par ne représenter personne. "Julie a 35 ans, 3 enfants en bas âge, elle vit en banlieue et travaille en centre-ville, elle fait du sport trois fois par semaine et voit ses amies souvent. Elle est très sensible aux changements climatiques. Elle a un chalet et un VUS, etc." À part dans les agences marketing, Julie n'existe pas.
Ensuite, ce persona représente la moyenne. Or nous l'avons déjà écrit dans un article, la moyenne n'existe pas. La création d'un persona moyen va pousser les départements marketing à créer une sorte de porte-parole d'un groupe, qui ne représente pas les disparités de celui-ci. Les différences sont effacées. Les incongruités sont ignorées. On dessine à grands traits un portrait idéal, uniforme, alors que c'est justement dans les subtilités de nos différences que l'innovation se cache. C'est aussi l'avis de Dan Formosa, un grand designer industriel interrogé dans le documentaire Objectified:
Certains de nos clients nous disent notre usager moyen est une femme, 42 ans, 2.3 enfants... Nous, on écoute poliment, mais... on s'en fout de cette personne. Ce qu'on a vraiment besoin de savoir pour designer, c'est le comportement des usagers extrêmes. Les plus forts ou les plus faibles, les athlètes, les plus rapides ou les moins agiles. On innove pour eux. La moyenne, elle... Elle va pouvoir s'arranger toute seule.
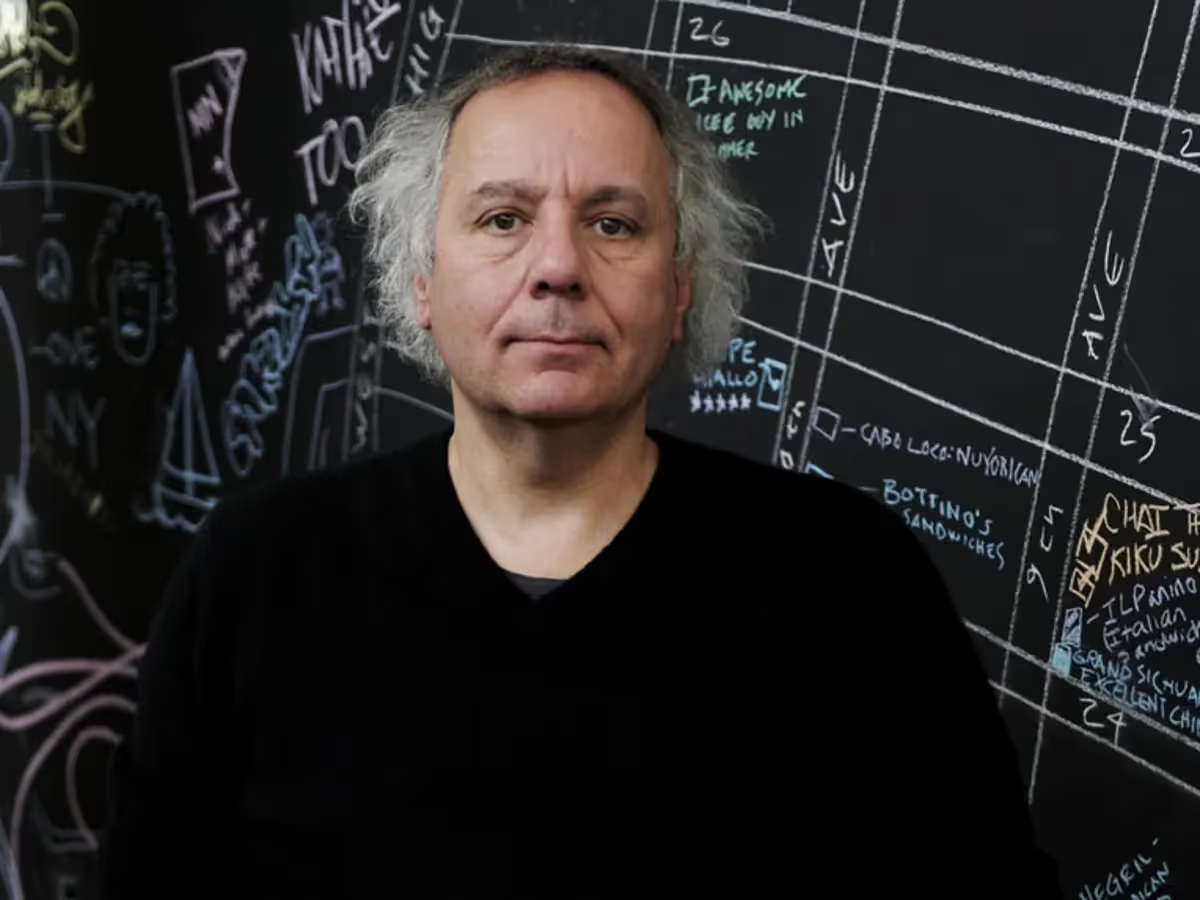
Cependant, il demeure un dernier problème qui nous oblige à faire un petit tour dans le passé.
L'étymologie du mot "persona" remonte au latin. Le mot latin "persona" signifiait initialement "masque" ou "visage" et était utilisé pour décrire les masques portés par les acteurs sur scène dans les théâtres romains et grecs antiques. Ces masques étaient souvent conçus pour représenter des caractères ou des types de personnages spécifiques, permettant ainsi au public de comprendre instantanément le rôle de l'acteur dans la pièce.
Au fil du temps, le sens du mot "persona" a évolué pour inclure non seulement le masque lui-même, mais aussi le personnage ou le rôle représenté par l'acteur. En fin de compte, il en est venu à représenter une identité ou un ensemble de caractéristiques adoptées par une personne dans un contexte particulier. Si on s'en tient aux origines, le persona est un personnage, pas une personne. On est donc passé du masque au personnage à la moyenne d'un groupe. Et c'est dommage...
Il existait déjà un mot pour décrire un groupe de personnes : un profil. C'est exactement la même définition — certains vous diront que le profil décrit "une personne" alors que le persona décrit un "ensemble de personnes". Mais alors on se prive d'une subtilité qui a beaucoup de valeur en anthropologie. Si le profil décrit la réalité et que le persona décrit un personnage fictif, alors on crée un écart entre ce que la personne est et ce que la personne pense ou aimerait être.
Chez Perrier Jablonski, nous sommes à la recherche d'insights en permanence, et sans trahir de secret professionnel, la vérité se cache souvent entre la réalité et le fantasme. Entre le profil et le persona. Par exemple, voici le profil d'Aurélien : il a 37 ans. Il a deux enfants et vit à Sherbrooke. Il travaille en construction. Voici le persona d'Aurélien: Aurélien se voit comme un gars de plein air qui pourrait vivre sur la route, à escalader les plus belles montagnes du pays et à vivre en pleine nature à l'année. On voit bien que ces deux Aurélien sont compatibles. On imagine bien le potentiel des insights cachés entre le profil et le persona d'Aurélien. Pourquoi Aurélien n'a-t-il pas fait le choix de vivre son rêve? Est-ce seulement un rêve ou un projet? Existe-t-il des empêchements à la réalisation de cette vie rêvée? Aurélien vit-il avec nostalgie? Comment fait-il cohabiter ces deux vies dans sa tête? Vit-il comme si il avait réalisé son rêve? Ces incohérences sont autant de questions qui pourraient nous aider à résoudre "l'énigme Aurélien". Pour faire cela, nous avons besoin d'un cadre plus solide, plus profond, et plus sérieux.
C'est à Carl Gustav Jung, un immense psychologue du XXe, que l'on doit l'idée d'archétype. Ce sont des modèles de comportement — ou de personnalité — qui ont un caractère universel et intemporel. On les retrouve dans les mythes, les légendes, les religions, la littérature et même le cinéma ou la télévision. Ils peuvent servir dans la création d'un persona, dans le sens qu'ils représentent une sorte de "caricature inspirante" — qui aurait l'avantage d'être compréhensible par tous. L'archétype devient alors un "super-persona" caricatural, certes, mais universel.
En voici quelques-uns :

Ils sont très pratiques à plusieurs égards. D'abord parce qu'ils sont clairs, évidents. Ensuite, parce qu'ils représentent la psyché humaine, qui est riche et complexe. Enfin parce qu'ils peuvent s'additionner dans la composition de votre persona. L'archétype nous permet alors d'assumer que l'humain en face de nous n'est pas simple... et l'insight peut nous permettre de résoudre notre énigme. Si Aurélien (avec son profil) n'agit pas conformément aux principes qu'il déclare (son persona), c'est sans doute qu'il a une personnalité complexe (son archétype).
Ainsi, pour éviter le piège du persona, on aurait avantage à décrire notre Julie comme un mélange de "profil-persona-archétype" — que nous avons renommé le P.A.P par convenance. Par exemple comme une femme de 42 ans, professionnelle, d'un niveau universitaire, qui habite en banlieue et travaille en centre-ville, qui aime le plein air et habite un 5½. Elle se voit comme une femme libre et proche de la nature, mais elle ne vit pas ce rêve. Pourquoi? Parce qu'elle a deux enfants, et que son rôle de mère passe avant tout. Mi-figure maternelle, mi-héroïne, elle a besoin d'être encouragée, supportée et valorisée. Elle n'a pas mérité de nouvelles injonctions ou des leçons de morale. Nous allons donc devenir la marque qui va faciliter sa vie, l'encourager et la soutenir, en faisant ceci ou cela.
Il existe trois types d’empathie et chacun de ces types agit sur une partie différente du cerveau. Il faut bien se comprendre, ici: les types d’empathie ne sont pas interdépendants et chaque personne a un degré d’habilité différent par rapport à ceux-ci.
C’est l’empathie que l’on connait tous: le fait de comprendre et de reconnaitre ce que l’autre personne ressent. Quand ton meilleur ami t’appelle pour te dire qu’il a décroché son emploi de rêve et que tu lui dis : « Wow, je suis tellement content pour toi ! » (et que vous êtes sincère), c’est ce qu’on appelle de l’empathie cognitive.
On l'appelle aussi l'empathie contagieuse. Avec ce type d’empathie, nous ressentons physiologiquement et physiquement ce que l’autre ressent grâce à des signaux verbaux et non verbaux. Ici, on parle ni plus ni moins de faire l’expérience des sentiments de l’autre. Oui, c’est celle-ci qui nous permet de ressentir un bon vieux malaise lors de nos vidéoconférences.
Cette empathie peut être définie comme une réponse émotionnelle de compassion et/ou d'inquiétude provoquée par le fait de ressentir que quelqu'un d’autre est dans le besoin. En d’autres mots, c’est l’empathie qui fait agir, c’est grâce à celle-ci que les gens passent à l’action pour remédier aux problèmes des autres. Sur le plan anthropologique, il a déjà été suggéré que l’empathie compassionnelle ferait partie du mécanisme évolutif qui permettrait à l’humain de posséder la grande motivation d'aider ses enfants en cas de besoin. Si les humains n'étaient pas si intéressés à aider leurs rejetons, notre espèce ne serait pas allée très loin…
Avoir une grande habileté par rapport aux types d’empathies cognitives permet de voir le monde à travers un oeil différent et de comprendre plus simplement un point de vue. En d’autres mots, quand on reconnait que notre interlocuteur a des émotions, nous pouvons mieux communiquer avec lui, car nous avons l’habileté de comprendre sa perspective des choses. C’est ça, la beauté de l’empathie: la capacité de « voir » le cadre de pensée des autres. Selon le Center of Creative Leadership, plus notre capacité à comprendre différents cadres de pensées est grande, plus notre performance au travail sera grande. Tout ça, grâce à la communication !
Tout comme nos muscles nécessitent un entraînement régulier afin de se développer et de devenir plus forts, l'empathie se perfectionne par des exercices assidus. En effet, bien que nous ayons tous des degrés différents d’empathies selon nos expériences de vie et notre environnement socioculturel, il est possible de pratiquer nos « muscles empathiques ». Pour ce faire, plusieurs psychologues proposent la pratique de l’écoute profonde (deep listening), ce qui consiste à écouter les gens de manière sincère et authentique. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Les expériences démontrent que plus nous écoutons les propos de l’autre sans préparer notre réponse, plus ils ''s'ancreront'' dans la partie de notre système cognitif responsable du traitement de l'information, et plus notre cerveau s’habituera à recevoir de l’information nouvelle et étonnante de manière détendue, réceptive et calme.
Chaque type d’empathie a un bénéfice différent selon les situations. Prenons l'exemple d'un travailleur social. Celui-ci n'a pas avantage à avoir une empathie émotionnelle grandement développée (comme pleurer quand un individu pleure). Cependant, une bonne empathie compassionnelle (celle qui fait agir) est une habileté qui caractérise un bon travailleur social, car celui-ci ne doit pas seulement comprendre les émotions d'autrui, il doit aussi avoir le désir profond d'aider les gens.
Oui, l'empathie est utile dans votre vie professionnelle, mais pas n'importe laquelle dans n'importe quelles circonstances: vous devez être précis par rapport au type d'empathie que vous voulez développer.
Nous devons comprendre que... nous ne comprenons pas. L’empathie ne nous permet pas de jouer les psychologues, elle ne nous permet pas non plus de reconnaître les intentions ni même les motivations des gens face à leurs émotions. Ainsi, nous pouvons ressentir une émotion, mais cela ne veut pas dire que nous savons pourquoi la personne ressent cette émotion. En fait, plus nous comprenons nos propres émotions, plus nous pouvons comprendre leur complexité. Aussi, il peut être risqué de déduire à partir des émotions d'autrui des intentions précises, car nous pouvons nous tromper complètement, et cela affectera grandement la communication. L’écart empathique est un bel exemple de ce risque !
Dans des cas de résolution de problème, les gens iront instinctivement discuter avec la personne qui a des expériences similaires. Ce choix est basé sur le réflexe empathique. Étonnamment, selon les recherches du Harvard Business Review, ceux qui ont subi des défis dans le passé étaient moins susceptibles de faire preuve d'empathie pour quelqu'un confrontée aux mêmes défis. C’est ce qu’on appelle l'écart d’empathie. Comprendre ce phénomène est d’une importance capitale pour notre communication avec autrui, surtout en situation de résolution de problème. L’écart empathique est un phénomène psychologique qui tend à diminuer le souvenir de la gravité de certaines situations passées.