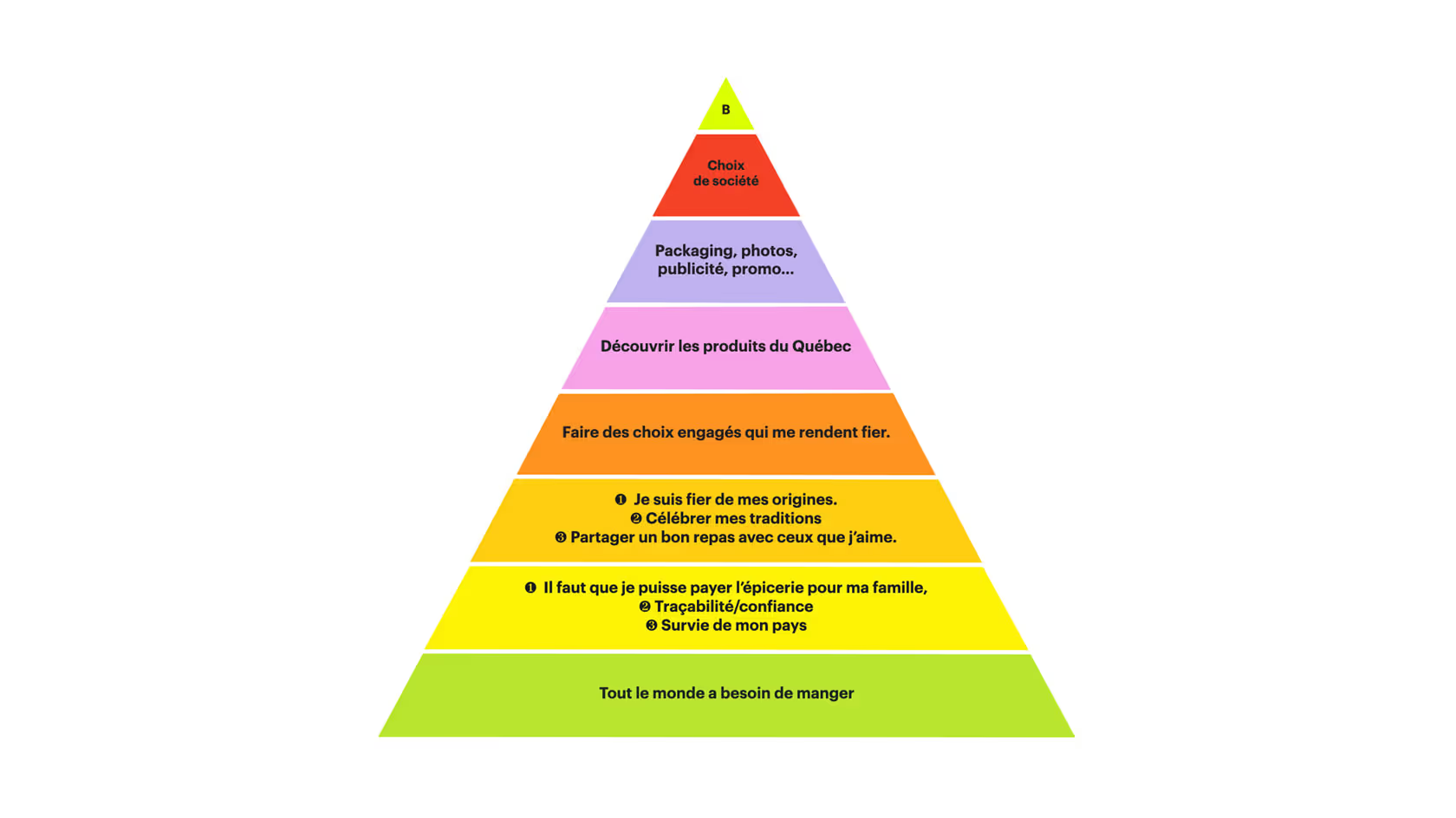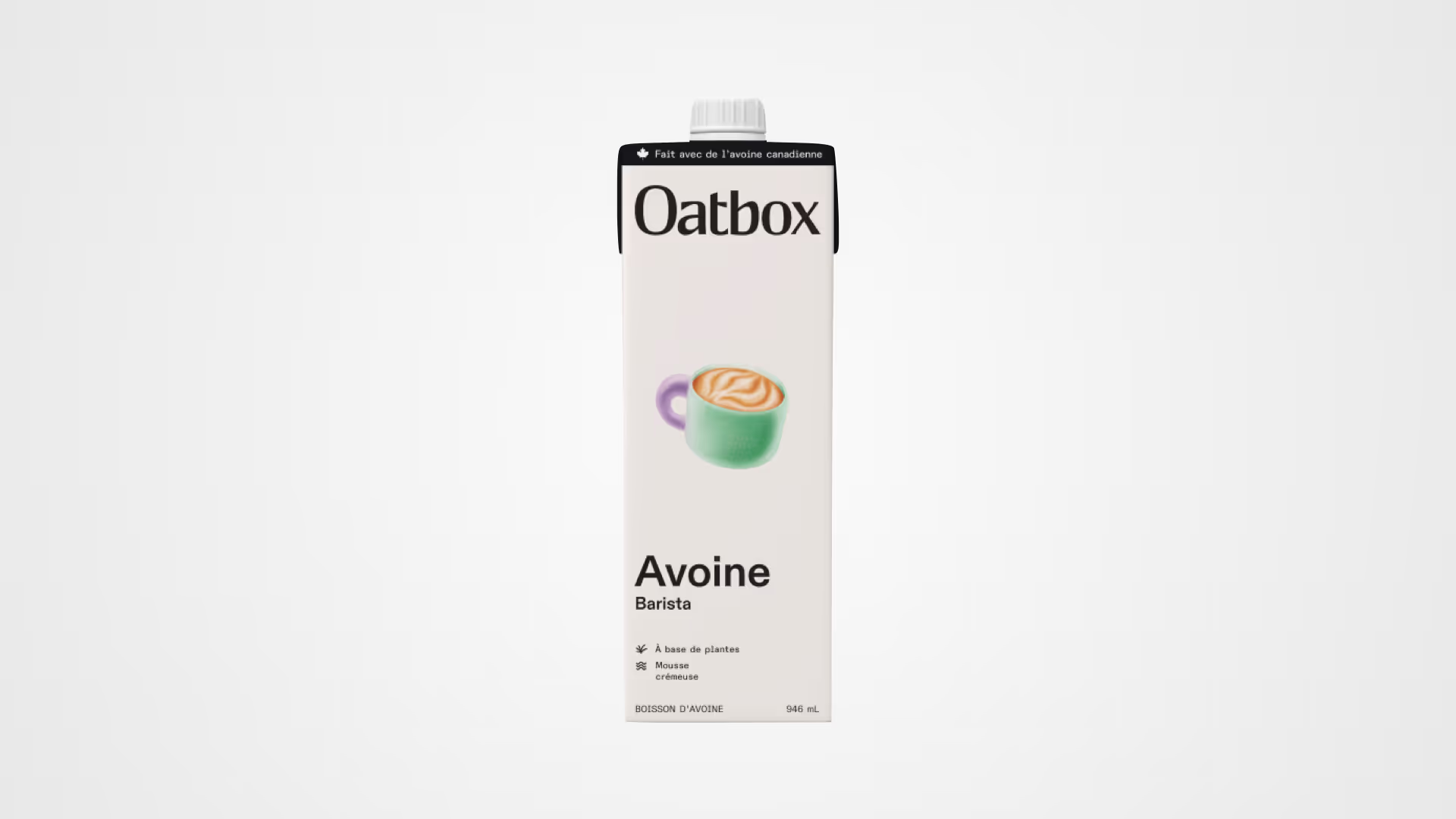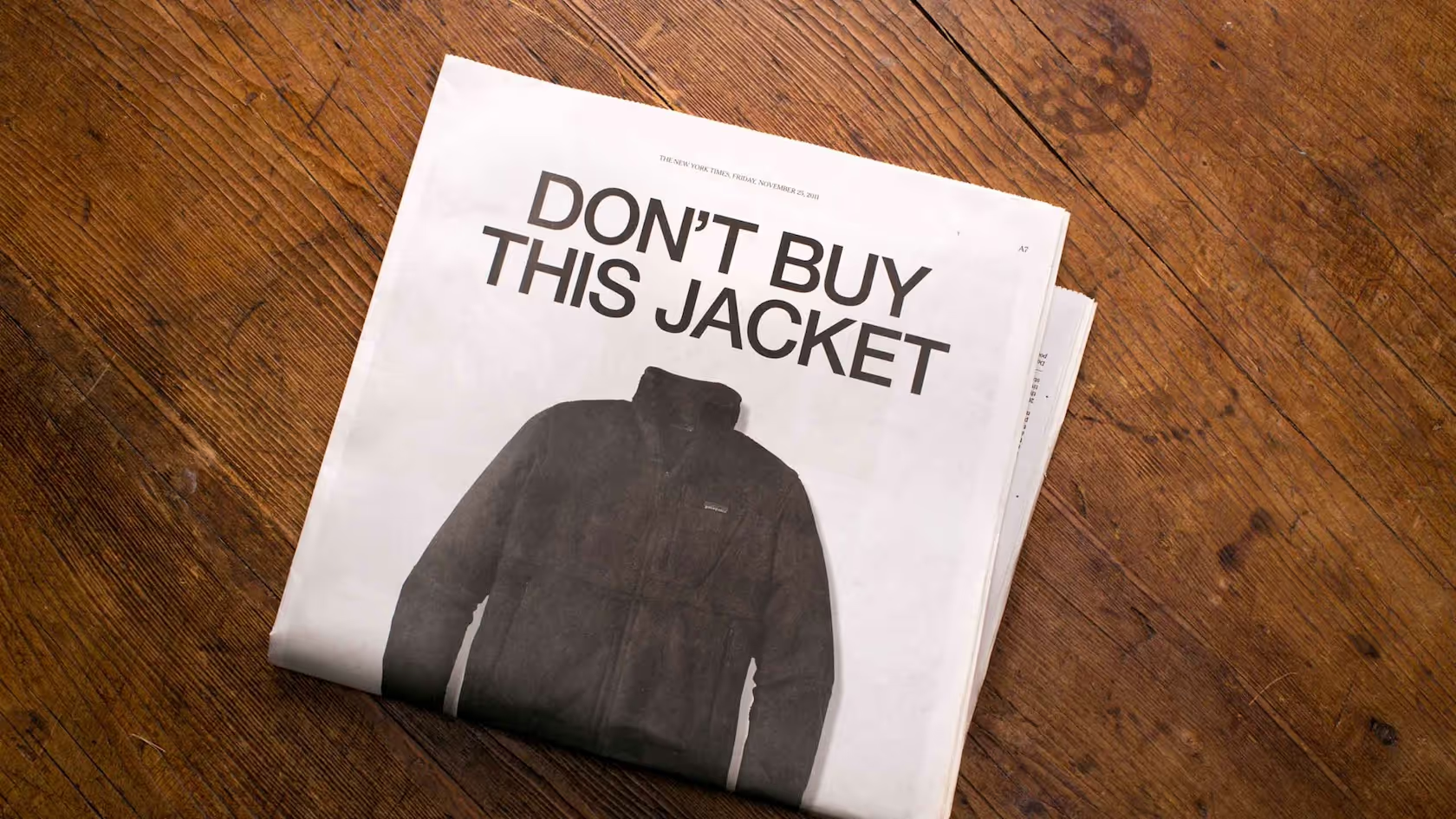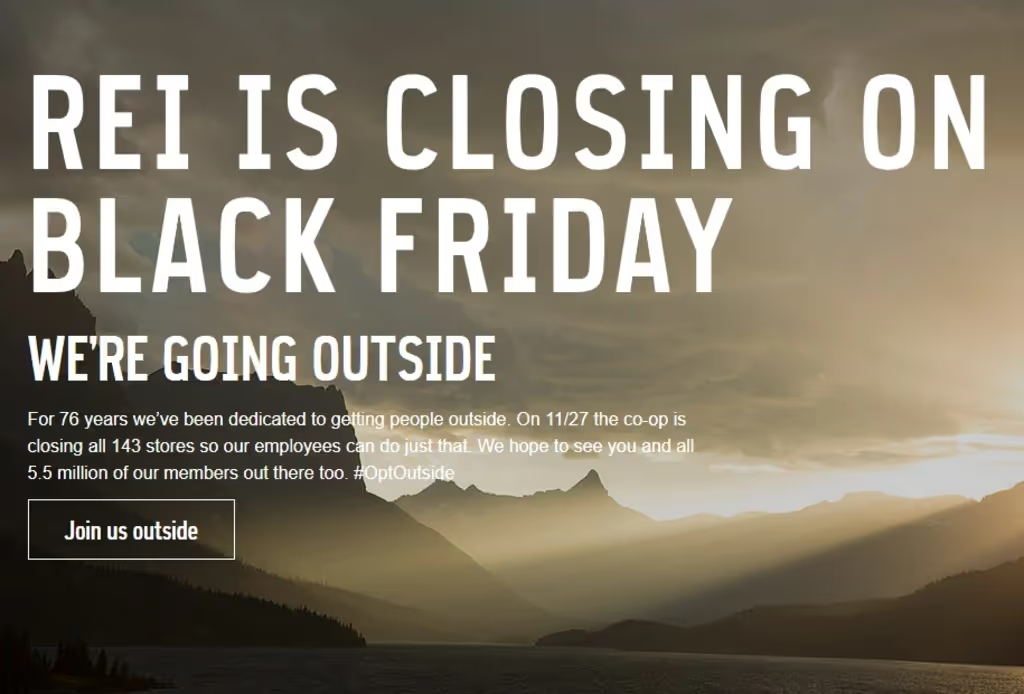Le marketing traditionnel repose sur le modèle des 4P : Produit, Prix, Place et Promotion. Ce cadre aide les entreprises à structurer leurs stratégies pour atteindre leurs objectifs commerciaux :
- Produit : Ce que l'entreprise propose à ses clients pour satisfaire leurs besoins ou désirs.
- Prix : Le montant que les clients doivent payer pour acquérir le produit.
- Place : L'endroit ou le canal par lequel le produit est distribué aux clients.
- Promotion : Les activités visant à informer et persuader les clients d'acheter le produit.
Cependant, le marketing social diffère en ce qu'il ne cherche pas à vendre un produit mais à promouvoir un comportement bénéfique. Il utilise donc un modèle adapté, le modèle des 5C, qui tient compte des spécificités et des défis uniques du changement comportemental.
Le marketing social est une discipline qui se concentre sur la promotion de comportements bénéfiques pour la société. Né en 1971, le marketing social est défini comme l'application des techniques de marketing commercial pour analyser, planifier, exécuter et évaluer des programmes visant à modifier le comportement d'une cible d'individus afin d'améliorer leur bien-être personnel et celui de la société. Contrairement au marketing commercial qui vise à générer des ventes, le marketing social cherche à induire des changements de comportement durables. Pour ce faire, il utilise un cadre unique : le modèle des 5C.
Les fondements du marketing social
Le marketing social repose sur l'idée que pour qu'un comportement soit adopté, les individus doivent percevoir plus de bénéfices que de coûts à l'adoption de ce comportement. Cette notion d'échange est au cœur des campagnes de marketing social. Si les individus voient des avantages significatifs à changer leur comportement (comme une meilleure santé ou des économies financières) et que les barrières à ce changement sont minimisées, ils sont plus susceptibles de s'engager dans le nouveau comportement.
Les 5C : un cadre pour le changement
Le modèle des 5C du marketing social comprend cinq éléments essentiels : Comportement, Coût, Communication, Capacité d'accès et Collaborateurs. Chaque composant joue un rôle crucial dans la conception et la mise en œuvre de campagnes de marketing social efficaces. Pour illustrer ce modèle — et éviter les biais produits par des campagnes existantes — prenons un exemple totalement fictif (et quasiment délirant) : "Adopter un lapin, ça fait du bien". C'est parti!
1. Comportement
Le premier C, Comportement, se concentre sur l'action spécifique que l'on souhaite que le public adopte. En marketing social, le comportement est l'équivalent du produit dans le marketing traditionnel. Pour la campagne "Adopter un lapin, ça fait du bien", le comportement cible est d'inciter les familles et les individus à adopter des lapins comme animaux de compagnie. En définissant clairement le comportement souhaité, la campagne peut développer des messages et des stratégies spécifiques pour encourager ce changement. On peu aussi estimer des mesures du succès, comme par exemple une augmentation de 25% des adoptions de lapins dans les refuges partenaires au cours de l'année.
2. Coût
Le deuxième C, Coût, représente les freins et les obstacles que les individus perçoivent ou rencontrent en adoptant le comportement souhaité. En marketing social, il est crucial de minimiser ces coûts pour faciliter le changement de comportement. Les coûts peuvent être de nature financière, psychologique, temporelle ou même sociale. Pour la campagne "Adopter un lapin, ça fait du bien", il faut considérer le temps et les efforts nécessaires pour s'occuper d'un lapin, les coûts des soins vétérinaires et l'espace à la maison. Pour réduire ces coûts, la campagne pourrait offrir des informations et des ressources sur les soins faciles des lapins, des coupons de réduction pour les premiers soins vétérinaires, et des kits de bienvenue pour les nouveaux adoptants.
3. Communication
Le troisième C, Communication, concerne les messages et les médias utilisés pour informer et persuader le public d'adopter le comportement souhaité. Une communication efficace est essentielle pour sensibiliser, éduquer et motiver le public cible. Elle doit être claire, persuasive et adaptée aux canaux de communication préférés de la cible. Pour la campagne "Adopter un lapin, ça fait du bien", le message clé pourrait être : "Un lapin, ça fait chaud au coeur" (OK, on confira ça à LG2 ou à SidLee au moment venu...) Les canaux de communication incluraient les réseaux sociaux, les affiches dans les parcs et les cliniques vétérinaires, les newsletters électroniques, les événements communautaires, les blogs sur les soins des animaux, et des campagnes de marketing d'influence avec des célébrités locales aimant les animaux.
4. Capacité d'accès
Le quatrième C, Capacité d'accès, se réfère à la facilité avec laquelle le public peut adopter le comportement souhaité. Cela inclut l'accès aux ressources, aux services et aux infrastructures nécessaires pour effectuer le changement. Pour la campagne "Adopter un lapin, ça fait du bien", il est important de faciliter l'accès à l'adoption de lapins en organisant des journées d'adoption dans les parcs et centres communautaires, et en simplifiant les procédures d'adoption en ligne. Des ressources telles que des guides pratiques sur les soins aux lapins, des vidéos éducatives et des lignes de soutien pour les nouveaux propriétaires de lapins peuvent également être mises à disposition.
5. Collaborateurs
Le cinquième C, Collaborateurs, implique les partenaires et les parties prenantes qui peuvent aider à promouvoir et à faciliter l'adoption du comportement souhaité. Les collaborateurs peuvent inclure des gouvernements, des organisations non lucratives, des entreprises privées et des leaders communautaires. Une collaboration efficace peut amplifier l'impact d'une campagne en mobilisant des ressources supplémentaires et en renforçant la crédibilité et la portée des messages. Pour la campagne "Adopter un lapin, ça fait du bien", les partenaires pourraient être des refuges pour animaux, des vétérinaires, des influenceurs animaliers, des écoles, et des entreprises de produits pour animaux de compagnie. Les refuges faciliteraient les adoptions, les vétérinaires fourniraient des soins initiaux gratuits ou à prix réduit, et les influenceurs partageraient des histoires positives et des conseils sur les soins aux lapins.
Et voilà!
Alors, êtes-vous prêt à passer à l’action? Le modèle des 5C n’est pas un mode d’emploi exhaustif, ni une recette clé en main. C’est mieux que ça : un point de départ. Un cadre de réflexion stratégique, accessible et pragmatique, pour structurer votre intuition, baliser vos intentions, et éviter les angles morts. Un peu comme un inventaire avant de partir à l’aventure. Ce que vous voulez changer, pourquoi ce serait bénéfique, ce qui freine, ce qui pourrait aider, qui pourrait embarquer avec vous. Pas besoin d’avoir toutes les réponses — mais il est temps de se poser les bonnes questions. Alors, qu’est-ce que vous voulez faire bouger, et par où allez-vous commencer?
Ce qu'il faut retenir
Le marketing social et le modèle des 5C offrent un cadre puissant pour concevoir et mettre en œuvre des campagnes visant à induire des changements de comportement bénéfiques pour la société. En se concentrant sur le comportement souhaité, en minimisant les coûts perçus, en communiquant efficacement, en augmentant la capacité d'accès et en collaborant avec des partenaires clés, les campagnes de marketing social peuvent surmonter les obstacles à l'adoption de comportements positifs et créer un impact durable.
Gaëtan est le fondateur de Perrier Jablonski et membre du C.A. de l’École Nationale de l’Humour. Créatif et stratège, il est aussi enseignant à HEC, à l’École des Dirigeants et à l'École des Dirigeants des Premières Nations. Certifié par le MIT (Design Thinking, I.A.), il étudie l'histoire des sciences, la philosophie, et les processus créatifs. Il est l’auteur de deux essais et 200 articles sur tous ces sujets.
subject
Bibliographie et références de l'article
L'I.A. a pu contribuer à cet article. Voyez comment.
- Nous utilisons parfois des outils de LLM (Large Language Models) tels que Chat GPT, Claude 3, ou encore Sonar, lors de nos recherches.
- Nous pouvons utiliser les outils de LLM dans la structuration de certains exemples
- Nous pouvons utiliser l'IA d'Antidote pour la correction ou la reformulation de certaines phrases.
- ChatGPT est parfois utilisé pour évaluer la qualité d'un article (complexité, crédibilité des sources, structure, style, etc.)
- Cette utilisation est toujours supervisée par l'auteur.
- Cette utilisation est toujours éthique :
- Elle est transparente (vous êtes prévenus en ce moment-même),
- Elle est respectueuse des droits d'auteurs — nos modèles sont entraînés sur nos propres contenus, et tournent en local lorsque possible et/ou nécessaire.
grid_view
Tableau de bord

no_photography
La vignette est manquante
done
Cet article est final.
spellcheck
Cet article est en relecture.
rule
Cet article a été remis à Gaëtan
badge
Cet article est encore dans les mains de l'équipe.
psychology
Cet article est un projet.
psychology
Cet article n'a pas de statut!
sell
Impact et local
sell
Aucun sujet sélectionné!
image
image
Il n'y a pas d'image HERO!
subject
Il n'y a pas de teaser!
photo_size_select_small
photo_size_select_small
Il n'y a aucune vignette!
hdr_auto
hdr_auto
Il n'ya a pas d'introduction!
copyright
Pas de légende d'illustration
copyright
Légende :
Gaëtan Namouric + MidJourney (6.0)





.avif)


.avif)