De la hauteur et de l’action
Le mot stratégie tire ses origines du grec ancien, où il combine deux termes : stratos signifiant « armée » et agein qui veut dire « conduire ». Initialement, la stratégie concernait donc l’art de conduire les armées, une compétence attribuée aux généraux. Cette notion s’est progressivement étendue au-delà du contexte militaire pour englober des domaines variés comme la politique, les affaires, les jeux et d’autres domaines nécessitant planification et tactique.
Dans son essence antique, la stratégie était intrinsèquement liée à la guerre et à la préparation des plans militaires non seulement pour vaincre l’ennemi, mais aussi pour sécuriser un avantage à long terme sur ce dernier. Le terme a été popularisé dans les travaux de stratèges militaires comme Sun Tzu dans L’Art de la guerre et Clausewitz dans De la guerre, où la stratégie est présentée comme une réflexion profonde sur l’emploi des batailles pour atteindre les fins de la guerre.
Au fil du temps, la notion de stratégie a été adoptée par le monde des affaires pour désigner l’art de planifier et de diriger des opérations dans le but d’atteindre des objectifs spécifiques. Dans ce contexte, la stratégie implique l’analyse des forces et des faiblesses internes d’une organisation, la compréhension de l’environnement concurrentiel, la prévision des évolutions futures et la préparation d’actions pour exploiter les opportunités tout en contournant ou en atténuant les menaces.
Attention cependant, à cet art de la planification, on doit aujourd’hui ajouter celui de l’improvisation. Le général Prusse Helmuth von Moltke du XVIIIe siècle le disait mieux que personne : « Si tu veux faire rire Dieu, raconte-lui tes projets. » Il convient de ne pas totalement mélanger la stratégie et la planification. Si prévoir est important pour donner des jalons à vos ambitions, s’adapter est vital pour naviguer dans un monde qui change.
Quand on me demande ce que je fais concrètement, je réponds que la stratégie consiste à rendre concret ce qu’on a dans la tête. Pour ce faire, en collaboration avec mon équipe, j’ai concrétisé davantage ce travail de... concrétisation. Une période d’observation, une période de réflexion, une période de formulation. On pourrait ajouter à cette séquence une couche méthodologique (quelles étapes, quels outils intellectuels utiliser ?) et une couche technologique (quels outils technologiques utiliser ?). Dans certaines organisations, on peut y ajouter des couches de sécurité, de gouvernance, d’éthique, etc., en fonction des besoins et des impératifs.
Aussi, « la » stratégie est devenue une gamme étendue de stratégies — chacune requérant une compréhension approfondie des objectifs à atteindre et des meilleures méthodes pour y parvenir.
Parlant de méthode, je confesse que cette volonté de « respecter » la stratégie a été ma première motivation, au moment de quitter le monde des agences de communication. En effet, elles sont souvent interpellées à la toute fin d’une réflexion qui a maturé parfois des années dans la tête du client. La nature du travail de créatif ou de stratège d’agence ne donne généralement pas accès à ces véritables problématiques, et le travail consiste donc la plupart du temps à concrétiser des solutions à des problèmes que vous n’avez pas choisis. Or le célèbre anthropologue Levi Strauss disait que « le savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses, c’est celui qui pose les vraies questions ».
Et c’est justement l’anthropologie qui a bouleversé mon entreprise, Perrier Jablonski. L’anthropologie est la science qui a pour objectif l’étude du groupe humain considéré dans son ensemble, dans ses détails et dans ses rapports avec le reste de la nature. Au fil des années, nous avons réalisé l’importance d’une méthode éprouvée afin d’arriver à nos fins : découvrir les vraies questions. L’anthropologie est une discipline qui a beaucoup à apprendre aux stratèges modernes — et je me permets ici un salut amical à mes confrères Jean-Sébastien Marcoux et à Jonathan Deschênes, de HEC. C’est cette discipline qui a conduit mon entreprise à transformer sa manière d’observer et donc de penser.
Le travail de stratège devient alors un travail d’écoute attentive et candide de celles et ceux qui peuvent informer le stratège sur l’objet de son attention, de son regard et de sa curiosité : équipe de direction, employés, clients, usagers extrêmes (allez lire l’article à ce sujet)... ils ont tous quelque chose à nous dire. Ce travail est mené par un anthropologue, qui va utiliser des outils variés (entrevue, observation, ZMET, photovoice, etc.) Ces observations vont se transformer en un rapport écrit, étape qui transforme alors l’anthropologue en ethnographe — celui ou celle qui écrit à sur les gens —, enfin… il écrit à propos des gens, car celui qui écrit sur des gens est un tatoueur.
Mon équipe et moi les appelons les observations ethnographiques. Elles sont comme une radiographie indiscutable de la situation donnée. Ce travail est alors présenté au stratège qui, avec ses connaissances, son expérience ou son instinct, va évaluer quelles observations nouvelles — quels insights — méritent un intérêt particulier. Et c’est là-dessus qu’il faut travailler. C’est à ces questions-là qu’il faudra répondre. Ce travail est alors appelé les observations éditoriales. Comme une interprétation de la radiographie par un médecin qui connaît son patient et les traitements disponibles et compatibles.
Cette année, nous avons passé le cap des 2000 entrevues ethnographiques, et je peux affirmer que Levi Strauss avait raison : l’art consiste à mettre le doigt sur les bonnes questions.
On ne se proclame pas anthropologue. On ne se définit pas soi-même comme stratège. L’anthropologie est une science, une discipline sanctionnée par un diplôme de cycle supérieur. La stratégie est un parcours professionnel. Après des études supérieures, le ou la stratège doit avoir cumulé des années d’expérience, au contact réel de clients variés et de problématiques diverses. Je dis souvent à la blague qu’on ne peut pas être stratège avant 40 ans. Certaines personnes sont plus précoces que d’autres, mais l’expérience est capitale. La stratégie n’est pas un travail théorique, c’est un travail de terrain.
Dans l’école pythagoricienne de Crotone, on pouvait suivre les enseignements du grand philosophe et mathématicien uniquement si l’on était un pytagoricien. Avant d’atteindre ce statut privilégié, on devait assister aux cours derrière un rideau, et prendre la parole était parfaitement interdit. De plus, le pythagorisme était un style de vie très encadré, hiérarchisé et basé sur des valeurs communes. Sans passer pour un réactionnaire antique, j’avoue que ces principes m’ont guidé dans le recrutement et ma formation des différents stratèges chez Perrier Jablonski. Je crois dans une méthode rigide, je crois dans une éthique anthropologique irréprochable, je crois dans le partage du savoir, je crois dans l’importance de l’écoute avant la parole, je crois dans une certaine esthétique de la pensée. Et je crois que le succès de la firme est en partie dû à cette forme de rigueur. En effet, les gens qui y travaillent n’ont pas besoin de réinventer la roue ou le bouton à quatre trous : ils utilisent toute leur énergie pour documenter leurs pensées, nourrir leurs pensées, penser, et formuler leur pensées.
Mais je ne crois pas vraiment au rideau. Soooo Ve siècle avant J.C…
Avec le temps, j’ai pu observer l’évolution de la pratique stratégique, et mon équipe et moi avons pu différencier dix types de stratégies, toutes au service de l’entreprise, de la marque, de ses dirigeants et de ses employés. Attention, il ne s’agit pas d’un dépliant publicitaire sur ma firme. Il s’agit plutôt d’un moment « portes ouvertes » qui révèle l’incroyable diversité des sujets qui nous ont été donnés à gérer depuis plus de neuf ans. Cet arsenal stratégique montre bien la grande complexité du métier de stratège aujourd’hui et l’éventail des outils à notre disposition. Évidemment, cet éventail varie de firme en firme ; il s’agit ici du nôtre, qui ne prétend pas être une vérité universelle.
J’assume le côté didactique — voire scolaire — de cet article. Mais voilà, enseignant la marque à HEC Montréal, je n’ai jamais trouvé de document qui rassemble tous les types de stratégies avec leurs livrables, et qui soit assez réaliste et assez à jour pour être enseigné. Pour les plus anciens d’entre vous, il s’agit d’un rappel. Pour celles et ceux qui commencent leur parcours de stratège, il s’agit d’un pense-bête qui vous sera bien utile !
Stratégie d’affaires : établir la direction future de l’entreprise
La stratégie d’affaires est cruciale pour tracer la route à long terme d’une entreprise. Elle repose sur l’implantation d’une vision claire (ce que j’appelle l’ambition) ainsi que sur l’établissement des aspirations futures de l’entreprise. Elle repose sur de grandes orientations stratégiques, sur des axes d’action et sur des objectifs. La stratégie d’affaires doit viser à simplifier son discours et à créer une harmonie au sein des parties prenantes, notamment l’équipe dirigeante et le conseil d’administration. Ce cadre sert de base à toutes les décisions, assurant cohérence et direction claire pour l’avenir. Le tout doit permettre l’alignement des parties prenantes, du conseil d’administration aux employés en passant par la direction.
Parmi les produits, services et livrables en stratégie d’affaires, on peut considérer les éléments suivants.
- Un ACCC : Il remplace le typique énoncé de mission/vision/valeurs. ACCC pour ambition, conviction, crédibilité et crédo — un thème couvert dans mon premier ouvrage Ce que vous avez à dire n’intéresse personne. Pour ce qui est des valeurs, les articles qui suivent vont régler leur sort.
- Une planification stratégique et ses outils : La planification stratégique est une démarche qui permet à une organisation de définir sa direction à long terme et les stratégies pour atteindre ses objectifs.
- Une analyse FFOM + PESTEL: Une évaluation des forces, ses faiblesses, des opportunités et des menaces pour identifier les points clés sur lesquels l’entreprise doit se concentrer.
- Un diagnostic organisationnel : Le diagnostic organisationnel est une évaluation systématique des différents aspects d’une organisation (structure, culture, processus, etc.) pour identifier les domaines d’amélioration et aligner ses ressources avec ses objectifs stratégiques.
- La mobilisation du C.A. (Conseil d’administration) : La mobilisation du C.A. consiste à accompagner le conseil d’administration dans certaines prises de décision. La réflexion collective et le partage de connaissances, d’insights, d’observations ou de tendances sont des outils importants pour y parvenir.
- L’arrimage C.A./direction/employés : Cet arrimage consiste au partage de certaines orientations entre le conseil d’administration et la direction exécutive de l’organisation, puis avec les employés, pour une cohésion et une efficacité accrues dans la poursuite des objectifs communs. L’idée : que l’ambition soit contagieuse et commune !
Toute stratégie d’affaires commence avec un ACCC pour déterminer la manière dont l’entreprise va se positionner dans son secteur pour se créer un avantage concurrentiel. Cet ACCC repose sur une démarche documentée par une analyse FFOM classique et la recherche d’insights anthropologiques.
Une fois l’ACCC complété, il convient de proposer les axes et les actions qui vont permettre de concrétiser l’ACCC dans l’organisation. La stratégie d’affaires influence et guide toutes les autres stratégies de l’organisation, notamment la stratégie financière, la stratégie de ressources humaines, la stratégie de développement de produit et la stratégie de marque, etc. Tiens, justement…
Stratégie de marque : se différencier sur le marché
La stratégie de marque est la pierre angulaire de la gestion d’entreprise. Elle définit le positionnement sur le marché et la communication avec les publics cibles, et renforce la différenciation vis-à-vis des concurrents. Elle vise la construction d’une image de marque forte et cohérente, d’une position unique dans l’esprit des consommateurs. L’ACCC (nommé plus haut) permet de créer un ancrage sûr et fidèle aux aspirations de l’entreprise, qui devra se décliner en attributs distinctifs. Ces attributs devront contribuer à bâtir une réputation solide et à inspirer confiance et fidélité. Ensemble, ces éléments façonnent la perception et la valeur de la marque sur le marché.
Parmi les livrables possibles en stratégie de marque, on peut considérer les éléments suivants.
- Un ACCC pour la marque (vu plus haut).
- Un diagnostic de marque incluant l’évaluation complète de l’état de la marque (forces, faiblesses, perceptions et insights).
- Un plan d’architecture de marques, quand plusieurs marques doivent cohabiter sous le même toit.
- Une guide de marque incluant le positionnement, le manifeste, la promesse, la personnalité et la tonalité de la marque.
- Un brief de création de marque, document stratégique qui réunit tous les arguments nécessaires à la création d’une plateforme de marque ou d’un guide de marque, la plupart du temps produit par des agences de communication ou de design.
Stratégie marketing : attirer et fidéliser vos différents publics
La stratégie marketing est cruciale pour le succès d’une entreprise, guidant comment elle interagit avec ses clients pour mettre de l’avant ses produits ou ses services. Elle inclut une série d’étapes stratégiques axées sur le client pour renforcer son lien avec la marque, parmi lesquelles : identifier et comprendre les différents segments de marché, choisir ceux qui correspondent le mieux à l’entreprise et positionner la marque de manière à se distinguer. L’ajustement de l’offre de produits ou des services aux besoins des consommateurs visés et la création de valeur pour ces derniers sont aussi essentiels pour augmenter leur satisfaction et leur fidélité. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des 4P, un modèle toujours actuel et efficace pour les stratèges.
Parmi les livrables possibles en stratégie marketing, on peut considérer les éléments suivants.
- Une analyse concurrentielle : Un rapport évaluant les principaux concurrents, leurs stratégies, leurs points forts, leurs points faibles et leur positionnement sur le marché.
- Des personas client : Nous y reviendrons un peu plus loin.
- Un plan marketing (stratégique) : Document qui résume la stratégie marketing globale, incluant l’analyse de la situation actuelle de l’entreprise, la définition des objectifs marketing, le ciblage de marché, le positionnement et la sélection des stratégies de marché.
- Un plan marketing (plan d’action et roadmap) : Un calendrier des initiatives marketing planifiées, y compris les campagnes, les lancements de produits, et autres activités clés, avec des échéances et des responsabilités assignées.
- Un tableau de bord de performance marketing : Un ensemble d’indicateurs clés de performance (KPIs) conçus pour mesurer l’efficacité des initiatives marketing par rapport aux objectifs établis.
- Un budget marketing : Un document détaillant la répartition des ressources financières attribuées aux différentes activités marketing.
- Un marketing Mix (4P) : Le classique : produit, prix, place et promotion.
Stratégie de communication : uniformiser la marque
La stratégie de communication est essentielle pour transmettre efficacement le message d’une marque à son public cible, en choisissant soigneusement les canaux adaptés, ainsi que le ton et le style des messages, pour garantir une uniformité de communication sur tous les points de contact. L’objectif principal est d’établir une relation basée sur la confiance et la reconnaissance avec le public. Cela implique de veiller à la cohérence des messages de la marque sur l’ensemble des plateformes de communication afin de consolider son identité et ses valeurs. Par ailleurs, la stratégie vise à engager le public en créant des contenus qui captivent, suscitent l’intérêt et incitent à l’interaction avec la marque. Une gestion proactive de la réputation de l’entreprise est également cruciale : elle utilise la communication pour forger et préserver une image positive, contrôler les perceptions publiques et réagir de manière efficace dans les situations de crise.
Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie de communication, on peut considérer les éléments suivants.
- Le plan de communication : Un document qui détaille les objectifs de communication, les messages clés, les audiences cibles, les canaux à utiliser et le calendrier des campagnes.
- Les canaux de communication : Un document stratégique qui prépare les réflexions de l’agence média. Il s’agit d’une réflexion de haut niveau qui prépare l’approche des médias traditionnels, numériques, sociaux ou de communication interne.
- Le brief de communication : Il permet de préparer la réflexion de votre agence de communication afin de définir les détails tactiques et concrétiser la stratégie de communication/marketing.
Stratégie de segmentation : affiner l’approche client
C’est le point de départ d’une bonne stratégie comportementale. Comprendre vos publics, leurs habitudes, leurs attentes, leurs besoins. Mais c’est aussi l’étape la plus délicate. La pensée magique veut qu’elle puisse être faite à l’interne lors d’un simple brainstorming. Or, il s’agit d’une étude anthropologique (parfois sociologique) qui sert à éviter les biais liés aux habitudes, historiques ou éditoriaux, du type « d’habitude on fait comme ça, avant on ne faisait pas comme ça, moi je ne ferais pas ça comme ça… » La stratégie de segmentation consiste à penser — ou repenser — la manière de « découper » votre clientèle. Parfois, les « cases » dans lesquelles vous avez placé votre audience ne donnent plus les effets escomptés. Il convient alors de les remettre en question et d’en proposer de nouvelles. Note pour les puristes : le terme stratégie de segmentation est une sorte d’abus de langage, car une segmentation s’observe, mais ne se décide pas. Dès lors, nous aurions dû l’appeler analyse de segmentation — mais le fait même de s’engager dans une réflexion sur la segmentation, et de la concrétiser, révèle tout de même de la stratégie. D’où stratégie de segmentation.
Voici les livrables les plus souvent considérés.
- Les profils/personas de la population à l’étude : Pour définir — ou redéfinir — vos publics cibles en évitant les biais.
- Le parcours-client : Pour mieux cerner le chemin qui mène vos clients à votre produit ou vos services.
- Les arbres décisionnels : Pour mieux comprendre le chemin du consommateur (client ou employé) jusqu’à vous.
Stratégie comportementale : influencer positivement les actions
La stratégie comportementale vise à analyser et à influencer les actions des consommateurs ou des employés pour atteindre les objectifs d’une organisation et optimiser l’efficacité des initiatives commerciales. Cette approche s’appuie sur des principes psychologiques et comportementaux pour élaborer des interventions ciblées encourageant des comportements précis. Ses éléments essentiels incluent le changement de comportement (visant à encourager des actions souhaitées telles que l’accroissement de l’utilisation d’un produit), l’amélioration de la productivité des employés et la promotion de modes de vie sains. La compréhension des motivations et des obstacles comportementaux est cruciale pour développer des stratégies qui répondent véritablement aux besoins des individus. En outre, cette stratégie mise sur des techniques comportementales pour booster l’engagement et la fidélité des clients ou des employés, créant ainsi une dynamique positive en faveur des objectifs organisationnels.
Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie comportementale, on peut considérer les éléments suivants.
- L’analyse comportementale : Étude approfondie des comportements actuels, des motivations, et des facteurs influençant les décisions des individus dans des contextes spécifiques.
- Les interventions basées sur le comportement : Conception et mise en œuvre d’interventions telles que des programmes de récompenses, des messages de motivation et des rappels pour encourager les comportements désirés.
- La mesure et l’évaluation : Définition des indicateurs de performance clés (KPIs) pour évaluer l’efficacité des interventions comportementales et ajuster les stratégies en fonction des résultats.
Stratégie de pitch : persuader et convaincre
Notre stratégie de pitch repose sur une préparation méticuleuse et une exécution maîtrisée pour transformer une proposition en une histoire convaincante et engageante. Cette stratégie englobe la compréhension profonde du public cible, l’articulation claire des avantages et des différenciateurs, et la capacité à susciter une connexion émotionnelle. Cette approche permet d’affiner le message en veillant à ce que chaque élément du pitch soit conçu pour maximiser l’impact et la résonance auprès de l’auditoire. La formation à la présentation et à la communication non verbale fait également partie intégrante de cette approche, assurant que les porteurs de projet peuvent livrer leur pitch avec confiance, clarté, et persuasion (si le sujet vous intéresse, reportez-vous au livre Ce que vous avez à dire n’intéresse personne). Cette stratégie vise non seulement à gagner le soutien et l’engagement des parties prenantes, mais aussi à établir une fondation solide pour des relations durables.
Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie de pitch, on peut considérer les éléments suivants.
- La conception ou la révision de pitch : Il s’agit de la préparation de votre document de pitch. Parfois produit en collaboration avec des designers, il s’agit ici de se concentrer sur les contenus.
- La synthèse et la rédaction : Il s’agit ici de préparer votre prestation orale et de vous assurer que vous avez toutes les cartes en main pour persuader et convaincre.
- Le coaching : Il s’agit ici de vous faire donner des conseils concrets sur votre prestation théâtrale lors du pitch. Présence, confiance, clarté : il faut vous présenter sous votre meilleur jour !
Stratégie éditoriale : prendre la parole… et la garder
La stratégie éditoriale vise à maintenir une communication constante tout au long de l’année en harmonisant le contenu avec le langage, les médias, les réseaux sociaux et les événements propres à la marque. Elle consiste à créer du contenu qui résonne avec le public, soutient les objectifs de la marque et stimule l’engagement auprès des communautés cibles. Cela inclut l’alignement du contenu avec l’identité, les valeurs, et la tonalité de la marque pour en renforcer la cohérence et l’impact. La production de contenu doit captiver les audiences, favoriser les interactions et consolider la relation marque-consommateur. L’intégration de techniques SEO est également cruciale pour augmenter la visibilité en ligne du contenu et, par extension, de la marque. Enfin, le contenu doit soutenir les objectifs commerciaux, comme les lancements de produits, les campagnes promotionnelles et la génération de prospects, contribuant ainsi directement au succès commercial.
Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie éditoriale, on peut considérer les éléments suivants.
- Une stratégie de contenus : Développer et diffuser un contenu pertinent et engageant qui attire et retient l’attention du public cible, soutenant ainsi la construction de la marque et la génération de leads.
- Un brief de narratif de marque : L’histoire de la marque qui connecte les produits ou services à des valeurs et à des expériences émotionnelles, renforçant l’engagement des consommateurs.
- Un calendrier éditorial : Il peut prendre la forme d’un plan organisé qui programme la création, la publication, et la promotion du contenu sur une période donnée, garantissant une présence constante et pertinente auprès du public.
- Une stratégie numérique de haut-niveau : Il s’agit ici de préparer les réflexions de votre agence média (ou agence numérique) pour l’utilisation des canaux numériques, y compris les médias sociaux, le SEO et le marketing par email pour atteindre le public là où il passe le plus de temps.
Stratégie en IA : préparer demain — et après-demain
Il est essentiel de développer une stratégie pour aider son organisation à faire face aux défis actuels et futurs du marché. Mais, attention, celle-ci doit prendre en compte une observation capitale : le principal défi d’une organisation face à l’IA n’est pas technologique. Le plus gros défi est humain. Les gens ont simplement… peur. Dès lors, la stratégie en IA consiste à réfléchir à l’adoption et l’acceptation sociale au sein de l’entreprise. Sans cette acceptation, pas d’intégration réussie ! En somme, elle prépare les humains de l’organisation à tirer pleinement parti de la technologie.
Parmi les produits, services et livrables possibles en stratégie d’IA, on peut considérer les éléments suivants.
- L’accompagnement des employés : Face à une équipe à rassurer, à mobiliser ou à outiller, il est important de faire un travail d’éducation, bien utile par ces temps anxiogènes.
- L’accompagnement de la direction ou du CA : Il convient aussi d’accompagner le conseil d’administration pour qu’il saisisse l’importance de l’IA, mais aussi ses limites et ses obligations.
- La réflexion éthique : Il s’agit de comprendre les risques et les limites de l’IA pour appliquer des règles simples et efficaces en matière d’éthique.
- La réflexion sur la gouvernance : Il convient d’orchestrer cette éthique à travers des rôles et des responsabilités pour gérer au mieux les données utilisées par l’IA.
- Le plan d’intégration de l’IA au sein de l’organisation : C’est l’orchestration de tous ces éléments dans le temps et dans l’organisation.
La stratégie de corpus
Cette stratégie vise à construire et à entretenir une base de connaissances organisée et dynamique qui peut être exploitée pour inspirer, informer, et guider les initiatives stratégiques, innovantes ou créatives. En rassemblant des études de cas, des recherches, des insights consommateurs et des exemples de meilleures pratiques, vos équipes de projet disposent des ressources nécessaires pour prendre des décisions éclairées et innovantes. Ce patrimoine intellectuel demande une gestion de corpus qui implique une curation rigoureuse et une mise à jour continue.
Cette stratégie se découpe en plusieurs étapes.
- La création et l’organisation du corpus : Cela consiste à créer ou structurer des ensembles de données et de contenus cohérents, favorisant une meilleure accessibilité et utilisabilité des informations stratégiques.
- L’analyse et l’extraction des connaissances : Il convient de transformer les données brutes en connaissances actionnables pour les décideurs. Il est donc essentiel de développer des méthodes d’analyse de données afin de pouvoir extraire de son corpus des insights précieux.
- Les stratégies de partage et de diffusion : Cela permet d’élaborer des stratégies de partage et de diffusion des connaissances au sein de l’organisation, renforçant la collaboration interne et l’efficacité opérationnelle.
- La formation et la sensibilisation : Cette étape vise à élever la compétence collective en gestion de corpus, assurant que tous les employés sont capables de contribuer à et bénéficier de la richesse des connaissances de l’entreprise.
- La gouvernance et les politiques de gestion : Il est parfois nécessaire d’élaborer des politiques de gouvernance du corpus, garantissant l’intégrité, la sécurité et la conformité des données et contenus.
- L’innovation et le développement continu : La dernière étape vise à instaurer un environnement propice à l’innovation continue, où le corpus devient une ressource vivante et évolutive, stimulant la croissance et l’avantage compétitif.
Stratégie de mobilisation
Terminons cette série avec une dernière stratégie que je n’ai pas comptabilisée dans mon top 10 puisqu’elle relève du comment plus que du quoi. Il s’agit ici de savoir comment mobiliser vos équipes, employés, direction, CA — clients, parfois —, et susciter des réflexions éclairées. Et c’est capital ! En effet, le concept d’une stratégie qui viendrait d’en haut — ou pire, d’ailleurs — est caduque et à proscrire, puisque l’adhésion de votre équipe va dépendre de sa collaboration au processus. Je vais m’en tenir à deux livrables — qui peuvent prendre beaucoup de formes.
- Des contenus pour des conférences, colloques, séminaires ou lac-à-l’épaule : Il faut développer des contenus propices au recul, à la réflexion, à l’engagement ou au passage à l’action. Ces contenus doivent être choisis harmonieusement en fonction des objectifs de l’événement. Ensuite, il convient de trouver les bons intervenants, les bons formats et les bons types de moments (déductif, inductif, pratique, exercice), puis de scénariser les interventions convenablement pour gérer l’énergie créative des équipes.
- De l’accompagnement au changement : Il s’agit d’équiper les gestionnaires pour leur permettre de gérer — ou d’affronter — le changement. Gestion des préoccupations, des nouvelles attentes ou des nouveaux besoins : l’idée est de donner de la confiance, des connaissances et des outils à celles et ceux responsables de changer les choses.
Cette liste représente l’idéal, comme si nous devions toujours construire une entreprise, une marque ou une prise de parole « à neuf ». Or, la plupart du temps, il existe un « avant nous ». Il existe des pièces de robot, que nous allons devoir faire cohabiter. C’est aussi ça, le travail d’un stratège.



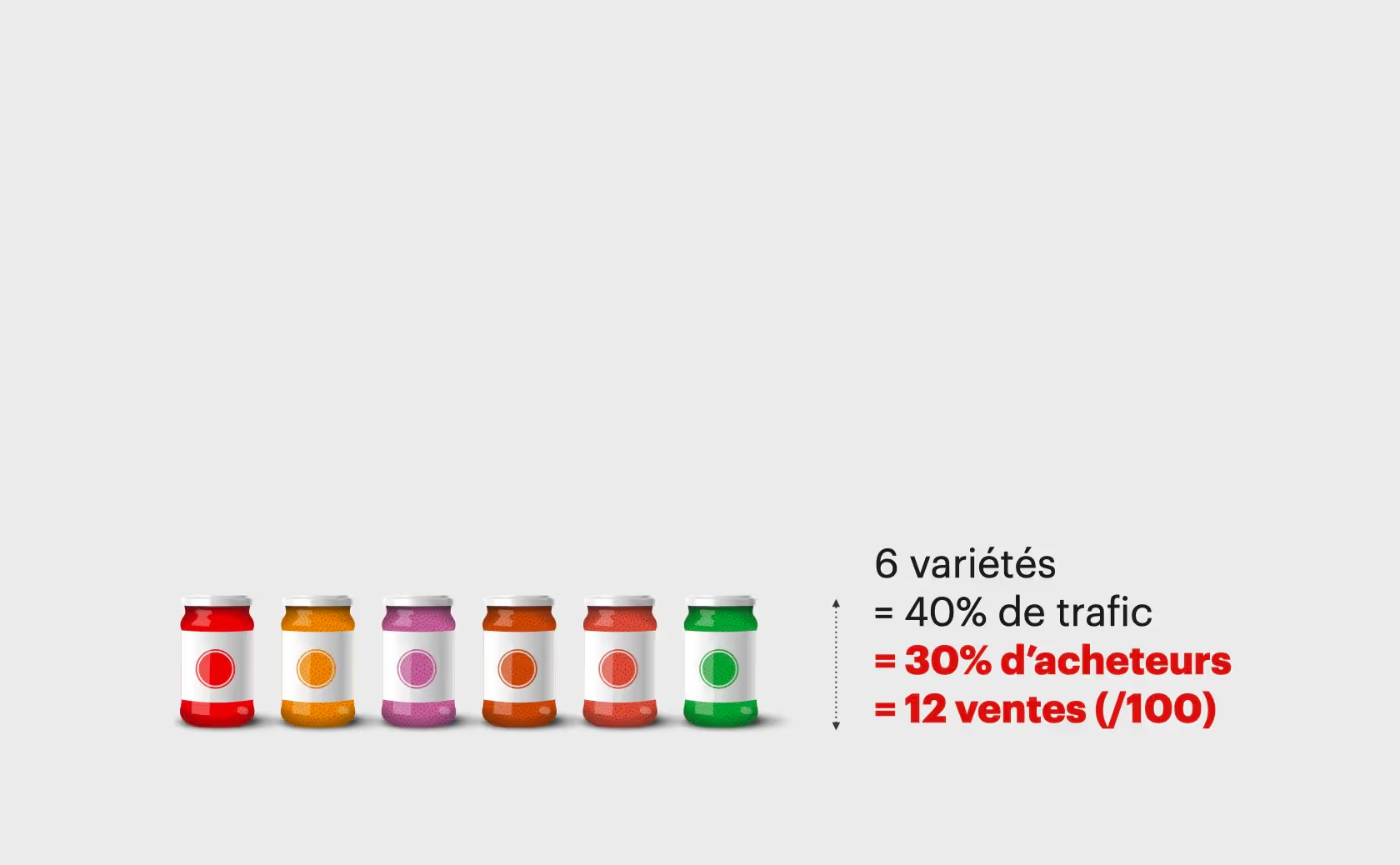
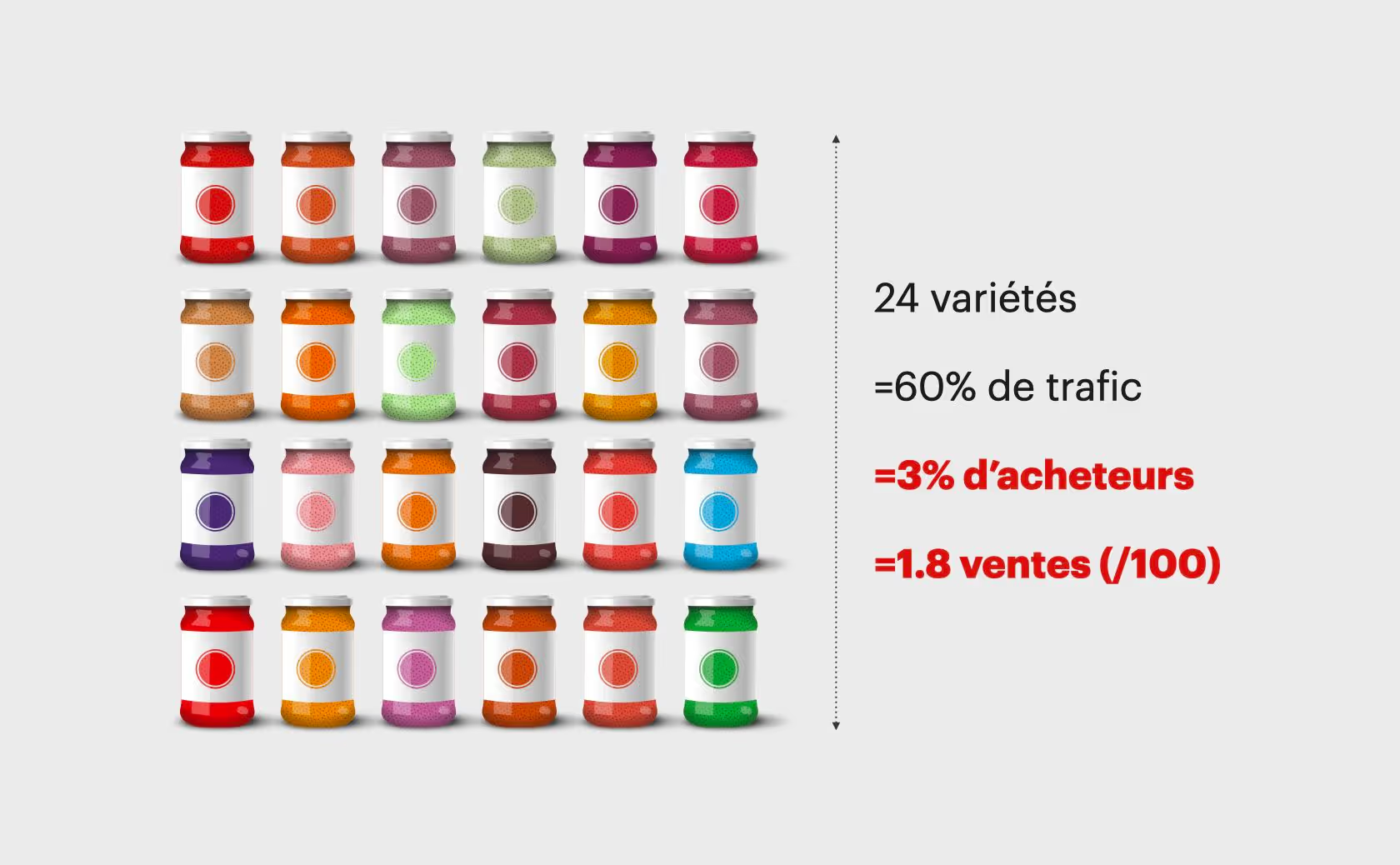




.avif)
.avif)


