
Douglas Hofstadter
C'est l'histoire d'un professeur à l'Université de l'Indiana à Bloomington, où il a longtemps été associé au département d'informatique et au Cognitive Science Program. Il est particulièrement connu pour son travail dans le domaine de la science cognitive, un champ interdisciplinaire qui implique la psychologie, l'informatique, la philosophie, la linguistique, et d'autres disciplines.
Hofstadter a dirigé le Center for Research on Concepts and Cognition (CRCC), un laboratoire interdisciplinaire axé sur la recherche en intelligence artificielle et en science cognitive. Son travail là-bas a été influent, notamment en ce qui concerne l'étude de la façon dont les humains perçoivent et traitent les concepts abstraits.
Les choses prennent toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter.
Hofstadter
Cette phrase, tirée du livre Gödel, Escher, Bach de Douglas Hofstadter, est plus qu’un clin d’œil à la complexité des projets humains : c’est une observation implacable sur notre incapacité chronique à estimer correctement le temps nécessaire pour accomplir une tâche.
Mais pourquoi cette loi semble-t-elle si universelle, si inévitable? Explorons ensemble son origine, ses manifestations et – surtout – comment y faire face dans un monde où le temps est souvent notre ressource la plus précieuse.
L’effet Hofstadter : Pourquoi nous sous-estimons (toujours) le temps nécessaire?
L’effet Hofstadter est un rappel à la fois frustrant et universel de notre incapacité à estimer correctement la durée des tâches. Si cette loi nous semble aussi familière, c’est qu’elle est étroitement liée à des biais psychologiques profonds qui influencent notre manière de penser et de planifier. Voici un décryptage des principaux biais qui sous-tendent cet effet.
1. L’excès d’optimisme
Nous avons naturellement tendance à minimiser les complications. Cette vision trop rose est renforcée par notre envie de croire que les choses seront simples et rapides. L’optimisme devient un filtre cognitif qui masque la réalité.
Exemple concret : Imaginez un équipe qui planifie le lancement d’un site web. Tout semble évident au premier abord : rédiger les textes, concevoir le design, coder les fonctionnalités. Mais une fois dans le vif du projet, les imprévus surgissent : demandes de modification du client, bugs techniques, délais pour valider les maquettes. Ce qui devait prendre deux mois finit par en prendre quatre.
Ce biais est amplifié par une certaine énergie initiale. Au début d’un projet, la motivation et l’enthousiasme peuvent éclipser les étapes laborieuses à venir.
2. L’oubli des imprévus
Nous prévoyons nos projets comme si tout devait se passer dans un scénario idéal, oubliant les détours et écarts inévitables. Ce biais reflète notre incapacité à intégrer les imprévus dans nos estimations.
Exemple concret : Prenez l’organisation d’un événement. Vous prévoyez tout : location de salle, traiteur, invitations. Mais vous n’avez pas anticipé que le fournisseur serait en rupture d’un produit-clé, ou que les conditions météo perturberaient la logistique. Ces petits détails, cumulés, prolongent le projet de manière significative.
En réalité, les imprévus ne sont pas l’exception. Ils sont la norme. Et pourtant, notre cerveau continue de les ignorer lors de la planification.
3. Le biais de planification
Nous planifions souvent comme si tout allait fonctionner parfaitement du premier coup. Ce biais est l’un des plus dévastateurs, car il repose sur une surestimation de nos compétences et une sous-estimation de la complexité des tâches.
Exemple concret : Vous prévoyez écrire un rapport important. Vous estimez que cela prendra une journée. Mais ce que vous n’intégrez pas, ce sont les interruptions (réunions, courriels urgents), le temps nécessaire pour vérifier vos sources ou pour éditer le texte. Résultat : la tâche s’étale sur plusieurs jours.
Ce biais reflète également une certaine myopie cognitive : nous prévoyons le déroulement d’un projet de manière linéaire, sans considérer les itérations, corrections ou ajustements qui s’imposent.
Comment atténuer l’effet Hofstadter
Pour contrecarrer ces biais, voici quatre stratégies pratiques :
- Multiplier vos estimations par deux (ou trois) : Une solution simple mais radicale : considérez que vos prévisions initiales sont trop optimistes. Si vous pensez qu’un projet prendra un mois, doublez ou triplez ce délai pour intégrer les écarts probables. Cette approche peut sembler exagérée, mais elle permet d’anticiper les retards liés aux imprévus et aux ajustements inévitables. Vous pouvez aussi demander à chaque membre d’estimer la durée d’une tâche, puis prenez la moyenne la plus pessimiste comme base.
- Planifier les imprévus : Ajoutez systématiquement une marge supplémentaire dans votre calendrier. Les imprévus peuvent inclure des retards administratifs, des problèmes techniques, ou des modifications de dernière minute. Cette marge doit être explicite et communiquée à tous les acteurs impliqués dans le projet. Si une tâche semble devoir durer 10 jours, prévoyez 12 ou 13 jours et indiquez clairement que cette marge est réservée aux imprévus. Ainsi, toute déviation ne met pas en péril l’ensemble du projet.
- Découper les tâches. Plus une tâche est petite, plus il est facile d’en estimer la durée avec précision. À l’inverse, les grands projets globaux sont généralement truffés d’incertitudes. Plutôt que de dire « réaliser un projet marketing », divisez-le en étapes : recherche de marché, création de contenu, tests A/B, et mise en ligne. Chacune de ces étapes peut être planifiée et ajustée indépendamment. Avantage : Cette méthode permet aussi de détecter plus rapidement les blocages et d’ajuster le tir avant que les délais ne s’accumulent.
- Utiliser des outils d’apprentissage. Examinez vos projets passés pour découvrir les tendances. Si un certain type de tâche a pris systématiquement 20 % de plus que prévu, appliquez ce correctif à vos futures estimations.
Quelques outils pratiques :
- Maintenez un journal de projet où vous notez les délais prévus, les délais réels et les raisons des écarts.
- Utilisez des logiciels de gestion de projet comme Trello ou Asana pour visualiser les progrès et ajuster les délais en conséquence.
Voilà. Oui, lire cet article vous a peut-être pris plus de temps que prévu. Maintenant, vous savez pourquoi. Et ce sera vrai pour tous les prochains projets que vous aurez à mener...
Ce qu'il faut retenir
Ces trois biais – excès d’optimisme, oubli des imprévus et biais de planification – sont autant d’obstacles à une estimation réaliste du temps. Mais prendre conscience de leur existence est déjà un premier pas pour mieux les contrer. Comment ? En adoptant des stratégies simples mais efficaces : ajouter une marge supplémentaire aux prévisions, anticiper les imprévus et découper les tâches en étapes précises. Parce que, oui, ça va toujours être long. Mais avec un peu de préparation, on peut transformer cette fatalité en opportunité de mieux planifier et, finalement, de mieux réussir.
Gaëtan est le fondateur de Perrier Jablonski et membre du C.A. de l’École Nationale de l’Humour. Créatif et stratège, il est aussi enseignant à HEC, à l’École des Dirigeants et à l'École des Dirigeants des Premières Nations. Certifié par le MIT (Design Thinking, I.A.), il étudie l'histoire des sciences, la philosophie, et les processus créatifs. Il est l’auteur de deux essais et 200 articles sur tous ces sujets.
subject
Bibliographie et références de l'article
L'I.A. a pu contribuer à cet article. Voyez comment.
- Nous utilisons parfois des outils de LLM (Large Language Models) tels que Chat GPT, Claude 3, ou encore Sonar, lors de nos recherches.
- Nous pouvons utiliser les outils de LLM dans la structuration de certains exemples
- Nous pouvons utiliser l'IA d'Antidote pour la correction ou la reformulation de certaines phrases.
- ChatGPT est parfois utilisé pour évaluer la qualité d'un article (complexité, crédibilité des sources, structure, style, etc.)
- Cette utilisation est toujours supervisée par l'auteur.
- Cette utilisation est toujours éthique :
- Elle est transparente (vous êtes prévenus en ce moment-même),
- Elle est respectueuse des droits d'auteurs — nos modèles sont entraînés sur nos propres contenus, et tournent en local lorsque possible et/ou nécessaire.


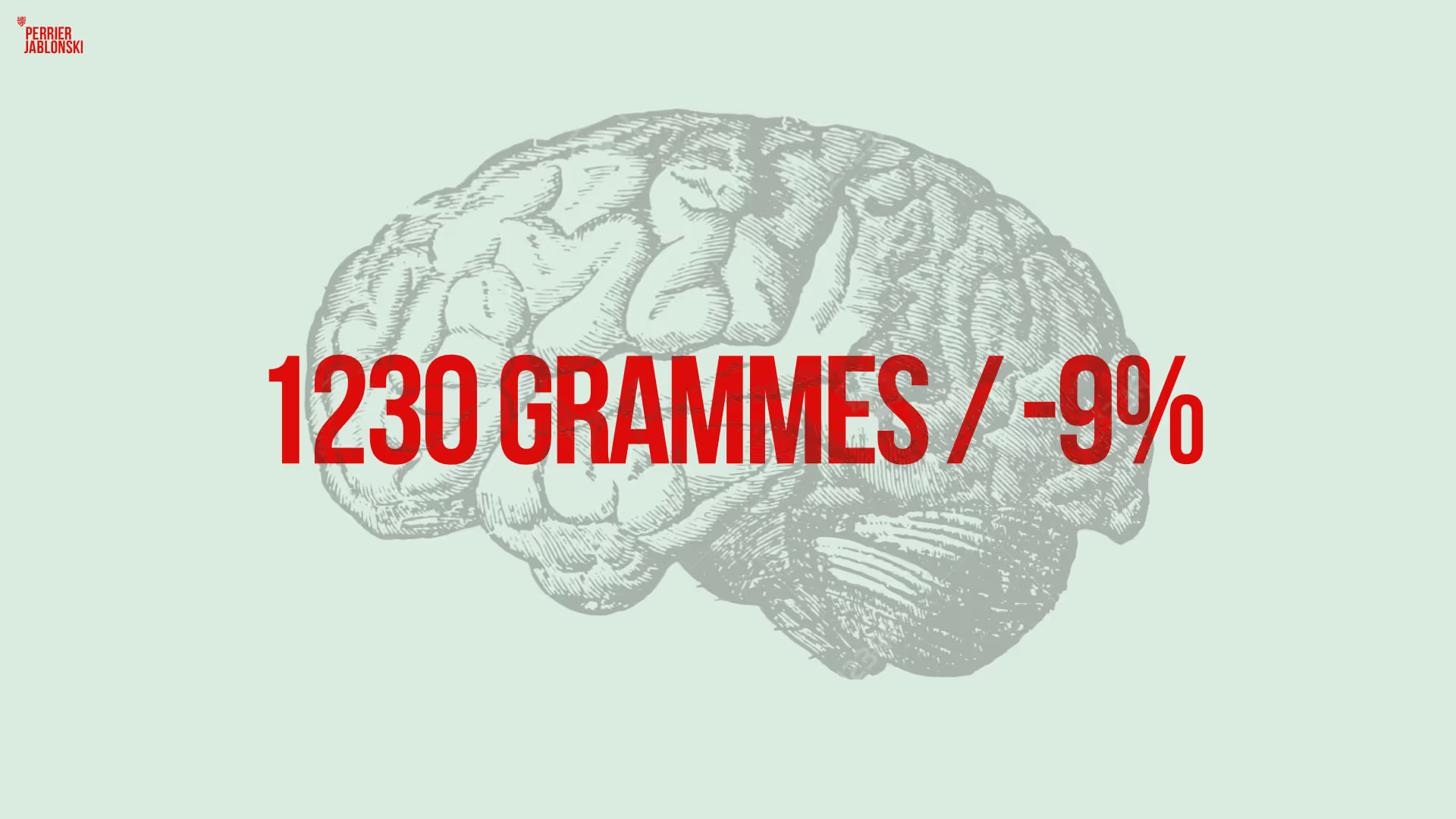
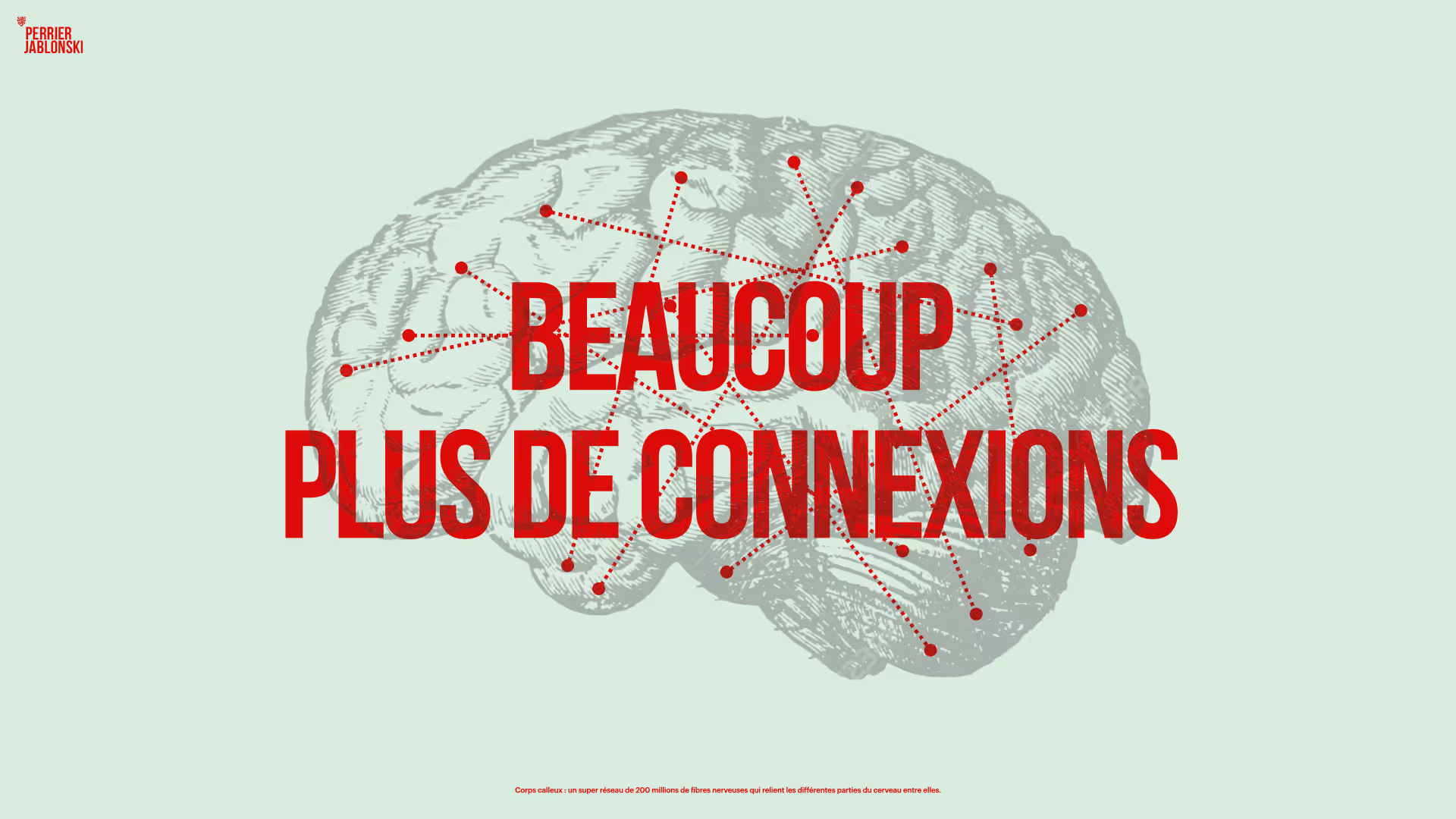


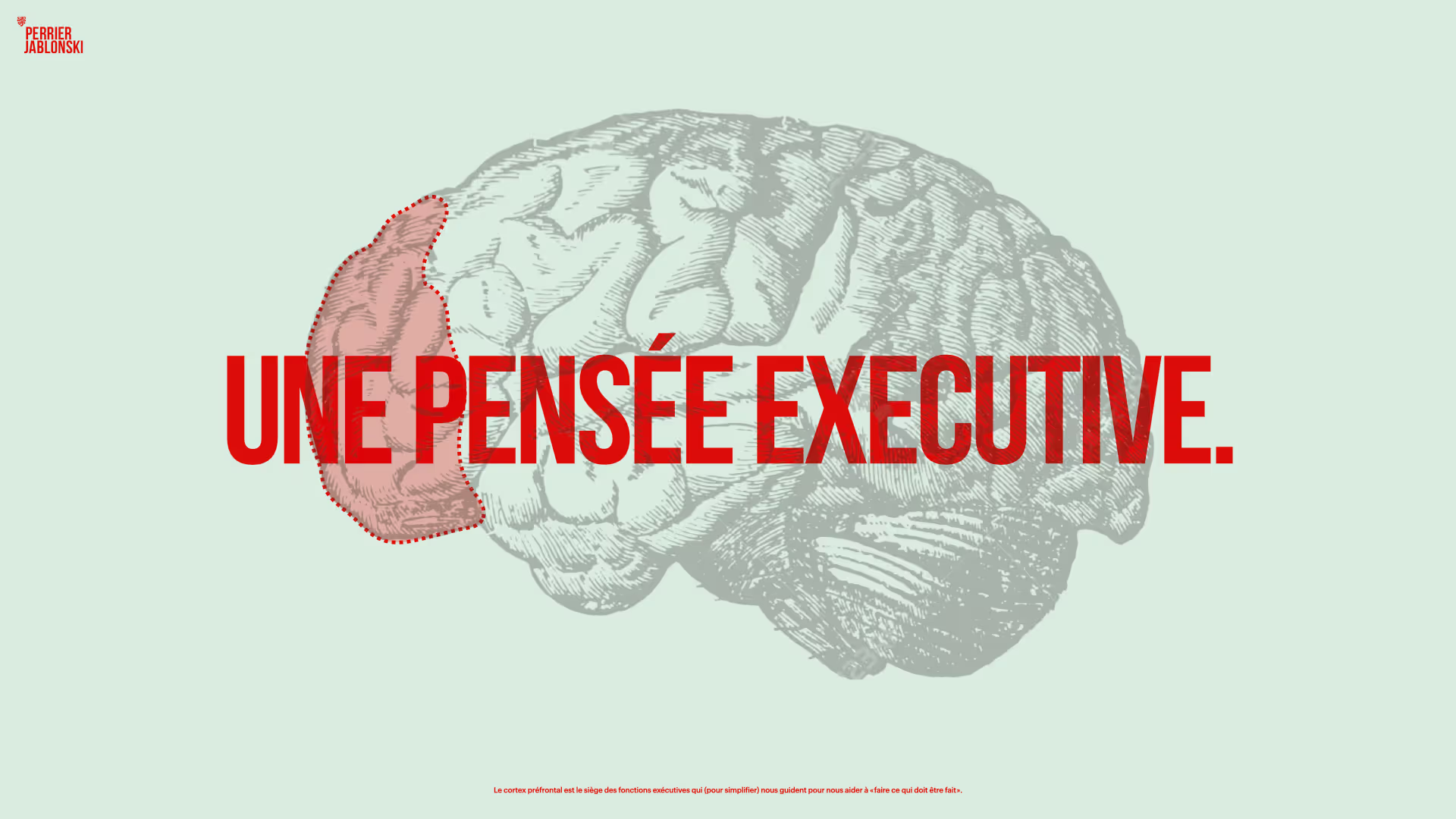
.avif)
.avif)


